1 Aperçu de la situation des mathématiques en Afrique et interpellation
L’Afrique est de loin le continent où les mathématiques sont le moins développées.
(Villani, 2010 : 8)
L’impact de l’adoption des principes mathématiques sur le quotidien du citoyen et de la citoyenne d’Afrique reste peu perceptible au point où cette quasi-absence d’effets tend à déterminer le désamour pour cette discipline; une situation qui amène à s’interroger sur la place, l’importance ainsi que l’avenir de cette discipline. Le mathématicien français Poincaré s’intéressait déjà en son temps à l’histoire et l’avenir des mathématiques (Poincaré, 1920), mais il explorait le sujet avec un regard occidental.
En Afrique, les acquis inestimables en matière de sciences ont été spoliés au cours de l’histoire (Fokam Kammogne, 2000) pendant les mouvements migratoires des populations résultant des différentes guerres sociopolitiques qui l’ont décimée. D’ailleurs, Gerdes (1994) présente un panoramique de résultats de recherche et des sources d’information se rapportant à l’histoire de la mathématique en Afrique subsaharienne. Pourtant, l’Afrique s’est toujours retrouvée en marge du développement des sciences mathématiques au point que Lumpkin (1987) se demande pourquoi le rôle et les contributions originales des Africain·e·s et de leurs diasporas dans le développement de la civilisation occidentale ont été omis ou relégués au second plan dans les manuels scolaires. Pourquoi le taux de décrochage et d’échec dans les filières mathématiques reste-t-il préoccupant?
Dans ce chapitre, nous examinons ce sujet avec un regard froid, en tirant avec Djebbar (2015) nos arguments du contexte africain à travers un état des lieux. Tout d’abord, nous dressons un bilan de l’échec et de décrochage dans les filières mathématiques, pour tenter de trouver des facteurs explicatifs tant à l’intérieur du système éducatif qu’à l’extérieur de celui-ci; ensuite nous analysons ces facteurs pour déboucher sur la nécessité d’agir suffisamment à temps pour mieux contrôler la dynamique du phénomène.
Constats généraux sur les pratiques d’enseignement-apprentissage et expérimentation des mathématiques
Taux d’échec et de décrochage élevés dans les filières mathématiques
Le bulletin de santé des mathématiques en Afrique et la situation de leur développement, dressés par Greenwald & Thomley (2012), révèlent globalement une difficulté majeure d’étudier les mathématiques africaines et les mathématiques en Afrique. Les autrices montrent l’existence d’une pratique ancienne des mathématiques, notamment à travers l’art et les jeux traditionnels. Toutefois, elles font remarquer que les systèmes éducatifs africains n’ont pas réussi à incorporer ces savoirs traditionnels pour en tirer le plus de bénéfice. C’est ainsi que nombre d’histoires anciennes sur les mathématiques africaines sont restées spéculatives, basées essentiellement sur une compréhension générale de la manière dont cette discipline évolue dans les autres sociétés. Cette rupture entre la vie et l’histoire d’une part, et l’éducation d’autre part entraîne des conséquences sur les performances scolaires. Aussi, dans son document de réflexion et d’orientation de l’année 2009, la Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (CONFEMEN) relevait-elle un certain nombre de « carences » qui affectent tant les infrastructures que les institutions en charge de l’éducation dans les pays africains francophones. De même, s’agissant de certains indicateurs scolaires peu reluisants en Afrique subsaharienne, Greenwald & Thomley (2012 : 13-15), se fondant sur le rapport de Mathematics in Africa de 2009, constatent qu’en Afrique centrale particulièrement, on enregistre de faibles pourcentages de fréquentation des écoles, un ratio apprenants/enseignant très élevé[1], un usage marqué des manuels scolaires mathématiques « recyclées » et peu d’enseignant·e·s formé·e·s dans la plupart de ces pays[2].
Le rapport 2009 sur les mathématiques en Afrique fait état de faibles pourcentages de la population scolarisée, de ratios élèves/enseignants élevés, d’une forte utilisation de manuels de mathématiques européens recyclés et de peu d’enseignants préparés dans la plupart des pays d’Afrique centrale, à l’exception du Cameroun. Tous ces faits rendent difficile la personnalisation de l’enseignement des mathématiques pour les élèves africains. Le Cameroun dispose d’un système éducatif plus développé, mais au niveau universitaire, il a du mal à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques qui ont été approuvés, et la plupart des cours de mathématiques y sont dispensés dans de grandes classes par du personnel de faible niveau. (Greenwald & Thomley, 2012 : 13-15)[3]
Des faits qui rendent difficile l’appropriation de l’éducation mathématique par les élèves et les étudiant·e·s africain·e·s. Cependant, le Kamerun[4] aurait développé un peu plus son système éducatif dans son ensemble, même si au niveau secondaire, il lutte encore pour répondre aux besoins en termes de places à pourvoir dans les filières mathématiques des facultés des sciences qui existent; sans oublier que la plupart des enseignements de mathématiques sont dispensés dans des salles à effectifs souvent pléthoriques, par des enseignant·e·s dont certain·e·s font quelquefois preuve d’une conscience professionnelle reprochable. Néanmoins, avec plus de la moitié de titulaires de doctorat en mathématiques de la sous-région Afrique centrale, ce pays pourrait y devenir leader dans l’éducation mathématique. Mais nous pensons que ce leadership camerounais annoncé et tant espéré risquerait d’être illusoire si ses « intellectuels » n’arrêtent pas de sacrifier l’école à des appétences politiciennes (Elanga Ateme, 2016), si des actions synergiques d’éducation, de formation, de contrôle et de suivi-évaluation de la jeunesse ne sont pas mises en place maintenant par tous les acteurs et toutes les actrices républicain·e·s compétent·e·s.
Greenwald & Thomley (2012 : 17) affirment qu’en Afrique de l’Est, le Kenya a des programmes de mathématiques de très haute facture au niveau du secondaire et qu’il a produit presque la moitié des docteur·e·s de mathématiques de cette sous-région. Malheureusement, la plupart des étudiant·e·s de mathématiques sont attiré·e·s par des professions autres que l’éducation, l’enseignement et la recherche à cause de la modicité des salaires dans ces secteurs socioprofessionnels. Dans cette sous-région d’Afrique, beaucoup d’efforts devraient donc être fournis au niveau du renforcement des structures pédagogiques pour améliorer l’éducation mathématique par le questionnement et pour la rendre aussi compétitive, c’est-à-dire capable d’innovations et d’inventions. Combien de ces thèses de recherche doctorale en mathématiques fondamentales ou appliquées corrélativement à celles d’autres disciplines sont soutenues en terre africaine[5] sans que les résultats ne profitent aux populations? Une réflexion sur cette question pourrait permettre de mieux apprécier le degré de maturité de l’Afrique, de celui de ses institutions scolaires et universitaires dans ce champ disciplinaire.
Les performances mensuelles, séquentielles ou trimestrielles des élèves sont des indicateurs clés de leurs niveaux d’acquisition des savoirs et de préparation aux examens de passage ou certificatifs. Celles de fin de la 4e séquence ou du deuxième trimestre sont d’autant plus importantes qu’elles sont calculées lorsque les taux de couverture des enseignements sont estimés à plus de 80 %. Au cours de l’année scolaire 2011/2012 par exemple, l’exploitation des données collectées auprès de quelques établissements de la région de l’Adamaoua a conduit aux statistiques suivantes : en classe de 3e, seulement 7,21 % d’établissements ont produit leur propre épreuve de la 4e séquence; 3,56 % ont pris pour épreuve de la 4e séquence l’épreuve zéro officielle du BEPC 2012 et le reste n’a pas du tout évalué. Les taux de réussite enregistrés en mathématiques pour cette 4e séquence ont été les suivants : classes de 4eA de l’Enseignement secondaire technique (EST) : 11,73 %; classes de 1re de l’Enseignement secondaire général (ESG) : 22,61 %; classes de 1re/EST : 18,54 %; classes Tle/ESG : 7 % et classes Tle/EST : 21 %.
Ces chiffres sont inquiétants et certaines raisons de ces mauvaises performances qui ont un rapport avec les enseignant·e·s et leurs enseignements seraient entre autres :
-
la mauvaise qualité des sujets (non-respect de la structure, mauvaise formulation des questions, objectifs mal définis, barème peu adéquat, mauvaise lisibilité du texte, etc.);
- la mauvaise préparation des élèves aux évaluations (complaisance pendant les séances de travaux dirigés et rigueur absolue lors des devoirs, évaluations surprises, etc.);
- les enseignements de qualité douteuse (objectifs mal définis et non atteints, mauvais choix concernant les activités de découverte et de consolidation proposées, absence de préparation de leçons, etc.);
- l’absence de stimulation suffisante de la pensée et de l’estime de soi chez les apprenante·s;
- la complaisance dans l’attribution des notes (notes fantaisistes ou imaginées sans évaluation préalable…) avec comme corollaire le niveau très insuffisant des apprenante·s;
- les méthodes d’enseignement peu interactives, mal adaptées aux intérêts et aux capacités des apprenante·s (l’élève n’étant ni au centre ni au-devant de son apprentissage);
- la mauvaise connaissance des réformes et des nouvelles définitions des épreuves d’examens par les enseignante·s. L’absence de correction des sujets des épreuves d’entraînement ou « épreuves zéros » par les enseignant·e·s sur le terrain, avec pour corollaire la légèreté dans les préparations matérielle et psychologique des élèves;
- l’absence de stratégie didactique ou de manifestation d’une passion susceptible d’émulation chez les jeunes apprenante·s.
Il faut aussi ajouter que les enseignant·e·s travaillent parfois dans un environnement peu confortable, peu agréable et caractérisé par des effectifs pléthoriques, une insuffisance ou mieux un manque de matériels didactiques, des bibliothèques qui, quand il en existe, sont pauvres en livres ou manuels adaptés aux programmes, des rapports de collaboration équivoques avec l’administration, etc. Mais le fait que les résultats des évaluations ne répondent pas aux attentes suscitera toujours des interrogations de la part de la communauté éducative. Et la responsabilité de l’enseignant·e sera toujours questionnée. Face à de telles difficultés, les acteurs et les actrices du secteur ont mis en place des cadres de réflexions et de solutions qui fonctionnent. Parmi ces actions, l’initiative de l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) participe de cette action réparatrice. Interrogé sur le bienfondé de cette entreprise, Villani répond :
J’y adhère pleinement. Ce projet a été bâti en effet à partir d’un constat. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes Africains viennent poursuivre leurs études scientifiques en France. Or une fois formés, très souvent ils y restent ou s’installent dans d’autres pays, les mauvaises conditions matérielles, mais aussi parfois un environnement politique difficile, ne les incitant pas à retourner dans le leur. Ainsi le très fort potentiel, notamment en mathématiques, que j’ai évoqué, ne profite quasiment pas aux pays d’Afrique. Avec l’Initiative Next Einstein, l’AIMS a décidé de prendre ce scénario à rebrousse-poil en choisissant d’installer en Afrique chaque centre de formation qui sera développé dans le cadre de ce réseau. Ce seront alors les professeurs étrangers qui se déplaceront sur le sol africain pour dispenser leurs cours. Ce long travail permettra ainsi de former une première génération de professeurs qui, eux-mêmes, formeront une seconde génération apte à former les étudiants et ainsi de suite. (Villani, 2010 : 8)
Au Kamerun comme dans la plupart des pays en espoir d’émergence, et même dans certains pays dits développés, la vision que l’opinion a des mathématiques influe sur l’orientation scolaire et universitaire des jeunes. En effet, pour une moyenne de 100 élèves qui frappent aux portes du secondaire général ou technique, environ 25 % seulement s’orientent quelques années après vers une classe de seconde scientifique ou technique industrielle. Et plus tard, moins de 10 % seulement arrivent en classe de terminale SM[6] ou technique industrielle. Ces proportions restent gardées même au niveau des résultats aux examens certificatifs.
Au Gabon, les résultats d’une étude sur les filles et les sciences dans ce pays, menée pendant l’année universitaire 2015-2016 par Maroundou à travers une enquête sur une période de quatre années de 2009-2010 à 2012-2013, auprès de 55 étudiantes des niveaux licence et master, ont révélé (Demba et al., 2020) que le choix des filières scientifiques, le « surtravail » et leurs compétences en sciences ont été des facteurs déterminants pour se maintenir dans ces filières. En effet, dès l’école primaire, 23,6 % de filles enquêtées envisagent faire des études scientifiques; 38,2 % renouvellent leur projet en classe de troisième et seulement 3,6 % confirment leur choix en classe de seconde scientifique (palier d’orientation) (Demba et al., 2020 : 58).
Il convient de signaler, non pour s’en réjouir, mais pour révéler le niveau de complexité transcontinental du phénomène, qu’en Europe également, la situation n’est guère reluisante.
En France par exemple, pour la période allant de 1851 à 2005, les proportions de jeunes qui optent pour les filières scientifiques et sollicitant un baccalauréat technologique sont restées très faibles, en dessous de 30 %.
Tableau 1 : Statistiques des inscriptions en filières scientifiques en France (1851–2005) – Source : Encarta, 2009.
En effet, l’observance d’une croissance générale des données du tableau 1 ci-dessus laisse croire que la situation change en s’améliorant au fil du temps. Dans le cas présent, il s’agit d’une illusion statistique, car ces données représentent les fréquences brutes qui ne tiennent pas compte des poids totaux des inscriptions. S’agissant des données relatives aux baccalauréats technologique et professionnel, il faut se rendre compte qu’en réalité, le calcul des fréquences relatives sur ces données révèle que le taux le plus bas, soit 16,91 % = (3,4/20,1)*100, est enregistré en 1970 et le pic 29,66 % est atteint en 2000, pour descendre à 28,68 % cinq années après. Pour la même période, le taux des inscriptions au baccalauréat professionnel est resté en dessous de 18 % : soit 6,43 % en 1990, 17,5 % en 2000 et 16,14 % en 2005.
La situation camerounaise examinée sous l’angle des mathématiques reste aussi mitigée bien que ce pays annonce connaître l’émergence à l’horizon 2035. À titre d’illustration, en 2000, un centre d’écrit de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire général avait enregistré un total de 983 candidat·e·s inscrit·e·s dont 589 (soit 59,92 %) pour les séries littéraires, 313 (soit 31,84 %) pour les sciences expérimentales (série D) et 81 seulement (soit 8,24 %) pour les sciences mathématiques. Cette situation reste d’actualité en ce début du 3e millénaire, même dans les pays dits développés. Ainsi, pendant les années 2012 et 2013, soit plus d’une dizaine d’années plus tard, ces proportions n’ont pas vraiment changé de façon significative comme l’attestent les données suivantes enregistrées au ministère camerounais en charge de l’éducation du niveau secondaire.
Tableau 2 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par la Direction des examens et concours (DECC)[7] – Source : www.minesec.gov.cm.

Ce tableau montre qu’en 2012, sur 202 189 enfants qui ayant frappé aux portes du secondaire, 159 873 soit 79,07 % se portaient candidat·e·s (avec certainement l’aval de leurs encadreurs·se·s et parents) pour l’enseignement général et seulement 42 316 soit 20,93 % pour l’enseignement technique et professionnel. Des proportions assez similaires ont été enregistrées en 2013 avec 78,87 % et 21,13 % respectivement. Pendant la même période et en fonction des besoins somme toute disproportionnés, l’État attribuait 91,78 % de places aux jeunes dans les Écoles nationales des instituteur·e·s de l’enseignement général (ENIEG) en 2012 contre 8,22 % seulement dans les Écoles nationales des instituteur·e·s de l’enseignement technique (ENIET). En 2013, l’attribution était de l’ordre de 92,76 % dans les ENIEG contre 7,24 % dans les ENIET. Pourtant, les responsables de l’éducation et les politicien·ne·s martèlent au quotidien que l’émergence économique passe par le développement technologique et industriel qui a fortement besoin des mathématiques pour s’implémenter.
Au sortir du cycle secondaire, ces disproportions semblent se maintenir, et même s’étriquer.
Tableau 3 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC)
Du tableau ci-dessus, il ressort qu’en 2012, sur 188 796 candidats au probatoire, 76,92 % appartenaient à l’enseignement général contre 23,08 % pour l’enseignement technique et professionnel. En 2013, les chiffres étaient de 197 424 avec 79,7 % pour l’enseignement général et 20,3 % pour l’enseignement technique.
Au Kamerun, le sous-système anglophone n’est pas du tout épargné par ce phénomène.
Tableau 4 : Statistiques 2012-2013 des inscriptions aux examens gérés par le General Certificate of Education (GCE) Board[8]

De ce tableau, il ressort qu’en 2012 dans le sous-système anglophone, 86,6 % de jeunes étaient candidat·e·s aux examens de l’enseignement général contre 13,4 % pour l’enseignement technique, et en 2013, on enregistrait 86,38 % contre 13,62 % respectivement. Entre 2011 et 2014, les informations collectées pour la région de l’Adamaoua révèlent, par rapport aux inscriptions enregistrées aux examens Probatoire et Baccalauréat, les chiffres suivants :
Tableau 5 : Statistiques 2011–2014 des inscriptions en maths aux examens OBC/Adamaoua – Source : Archives DRES/AD.

En général, les résultats obtenus en mathématiques pour tous les examens officiels ne sont pas du tout reluisants, et ils ne sont pas de nature à développer de la sympathie à l’égard de cette discipline. Les performances dans les classes intermédiaires sont également mitigées. En effet, en octobre 2010 à l’occasion d’un séminaire de renforcement des capacités des animateurs pédagogiques des sciences de la région de l’Adamaoua, un inspecteur pédagogique de mathématiques, Monsieur Adjaba Biwoli, dans son propos introductif aux travaux en atelier, déclara :
Les mathématiques restent un grand facteur d’échec scolaire. Cette année par exemple, 4,9 % des élèves de notre région ont eu la moyenne en mathématiques au BEPC et 16 % seulement au Probatoire D. Pourtant, le sujet du BEPC concerné était essentiellement constitué d’exercices isomorphes […] à ceux régulièrement traités en classe! Au probatoire D aussi, nos candidats se sont montrés en majorité, incapables de traiter les exercices similaires à ceux abordés en classe et pire, pantois devant ceux de type nouveau. Les raisons évoquées par les enseignants ne manquent pas de pertinence. Seulement, leurs pratiques de classe favorisent-elles toujours le réinvestissement des connaissances dans des exercices classiques ou innovants? (Adjaba Biwoli, propos recueillis par l’auteur, 2010)
Au cours de ce séminaire qui avait pour thème central « Comment amener les élèves à pouvoir réinvestir leurs connaissances en mathématiques? », il s’était agi de mettre sur pied des stratégies opérationnelles plus efficientes devant contribuer au renforcement de l’autonomie dans le travail des apprenant·e·s.
Au regard de cette observation, nous nous étions engagé·e·s, dès le lendemain, à suivre les résultats en mathématiques aux examens des sessions à venir. Aussi, pour l’examen certificatif du BEPC en particulier, il ressort cet extrait des statistiques régionales.
Tableau 6 : Taux de réussite 2011 – 2014 en mathématiques au BEPC/Adamaoua – Source : Archives DRES/IPR/SC/AD
Ces données qui donnent l’impression que la situation est relativement stable dans l’Adamaoua corroborent à souhait la thèse selon laquelle peu de jeunes réussissent dans les séries mathématiques. La hausse relative du taux de réussite en mathématiques en 2014 peut davantage se justifier par la taille réduite de l’échantillon considéré que par l’amélioration des performances des candidat·e·s. D’autres chiffres disponibles, relatifs aux performances des candidat·e·s aux trois examens (BEPC, Probatoire et Baccalauréat) des sessions 2011 et 2012 dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est et du Sud se présentent comme suit.
Tableau 7 : Quelques chiffres des examens 2011 et 2012 dans trois régions du Kamerun[9] – Source : Observatoire des examens 2012/SS-MATHS/MINESEC.

Pour ce qui est du BEPC particulièrement, les chiffres enregistrés sont aussi parlants. En 2015, sur un échantillon de 813 candidat·e·s d’un centre de corrections, seulement 36 ont eu une moyenne au-dessus de 10/20 en mathématiques, soit un taux de réussite très bas de l’ordre de 4,42 %. Cinq années après, c’est-à-dire en 2020, la situation ne s’est guère améliorée. La synthèse des chiffres tirés des rapports des chef·fe·s de secrétariat de trois grands sous-centres[10] de corrections du même examen dévoile un niveau de performance très préoccupant : pour un échantillon représentatif de 3 988 copies de mathématiques corrigées, seules 158 copies ont porté une note totale définitive au-dessus de 40/80. Soit un taux de réussite d’environ 3,96 %. Les arguments susceptibles d’apporter des justificatifs recevables à ce statu quo dans la dynamique des performances des candidat·e·s sont essentiels pour réorienter et renforcer la lutte contre les phénomènes d’échec et de décrochage. Dans le cas présent, à quel degré la baisse constatée est-elle imputable à la situation de la Covid-19?[11] Et même si c’était le cas, cette pandémie ne constituerait qu’un élément aggravant qui vient s’ajouter à un problème déjà existant. Compte tenu du fait que les enseignements en présentiel connaissent déjà un certain nombre de problèmes encore sans solutions (la répartition des élèves par classe, par exemple), comment imaginer les images géométriques à la radio ou la télévision? Cette approche d’enseignement/formation à distance ne crée-t-elle pas davantage de problèmes au rang desquels les inégalités d’accès aux différentes formes de savoirs entre les apprenant·e·s?
Par ailleurs, la programmation des horaires de passage de certaines épreuves scientifiques à cet examen, ainsi qu’au Probatoire et au Baccalauréat scientifiques de l’enseignement général ne joue pas toujours en faveur du relèvement du niveau des performances des candidat·e·s. En effet, l’épreuve de français qui passe en priorité aux premières heures de la matinée dans le programme du déroulement des épreuves écrites regroupe à elle seule trois épreuves pour 3 heures 45 minutes : Orthographe (45 minutes), Étude de texte (1 heure) et Composition française (2 heures). Cependant, les mathématiques qui sont également une discipline transversale enseignée depuis le cycle maternel sont réduites à une seule et très longue[12] épreuve qui ne dure que deux heures. De plus, il faut constater pour le déplorer que dans les séries C, D et TI (Technologie de l’information), le passage des épreuves des matières phares comme la Physique-chimie, les Sciences de la vie et de la terre et l’Informatique, c’est-à-dire les matières du premier groupe dans les programmes d’enseignement, soit programmé pendant les deux dernières journées sur les quatre que couvrent les examens. Les élèves affrontent ainsi leurs matières principales dans un état psychosomatique de fatigue agissante.
L’Enseignement technique et professionnel n’est pas sans connaître aussi de telles performances; car ici également, les filières industrielles technologiques (secteur du tertiaire avec les parcours comme la fiscalité, la monnaie et les finances) qui exigent de bonnes bases en mathématiques sont peu fréquentées par les jeunes, au profit de certaines spécialités dites commerciales[13] qui en demandent moins. L’enseignement supérieur a également fort à faire pour sortir de cette situation (Banque Mondiale, 2003 : 90).
De nombreux jeunes éprouvent des difficultés en mathématiques. Plusieurs abandonnent cette discipline ou choisissent des formations qui leur permettraient d’éviter tout contact avec elle. Cette situation conduit à la circulation et à la diffusion d’un certain nombre des préjugés rétrogrades et même des mythes relatifs à cette discipline (Flato, 1990; Kindschi, 2005). Dans les institutions scolaires et mêmes universitaires, certains jeunes entrent en salle de cours avec la certitude que la leçon sera ennuyeuse. D’autres croient que la réussite dans cette matière dépend de la possession d’un talent ou d’un don spécial (supérieur), la fameuse « bosse des maths », oubliant parfois que l’enseignant également ne sait absolument pas tout. Les mathématiques ne sont pas réservées à une catégorie de personnes, scolarisées ou non scolarisées. Elles sont la façon de penser opérationnelle et opératoire de chacun. Les mathématiques élémentaires exemptées de leurs symboles et autres figures géométriques sont une activité populaire qui n’exige aucune condition fondamentale préalable pour les exercer, les pratiquer à une dimension élémentaire. C’est là le tremplin pour toute phase d’apprentissage. Des enfants aux adultes, aucun n’échappe aux mathématiques; tous et toutes les pratiquent de manière consciente ou inconsciente.
Persistance des préjugés néfastes sur les mathématiques et nos motivations
Nous avons aujourd’hui la certitude que les craintes causées par les mathématiques en milieux scolaire (Inanan Kouéiwon, 2018) et universitaire (Pilon, 2006) sont importantes et elles influent sur les comportements psychosociaux de nombreux individus notamment en Afrique malgré les innovations pédagogiques, didactiques et technologiques de plus en plus modernes. Il s’agit bien entendu de ce comportement réfractaire couplé à une antipathie à l’égard des sciences mathématiques, résultat des jugements préconçus, défavorables et erronés qui dénaturent l’esprit de cette matière et provoquent de multiples démissions non seulement dans cette discipline, mais aussi dans les filières apparentées. Ce mouvement prend d’ailleurs, et depuis un certain temps, une autre forme. On donne l’impression de s’intéresser aux mathématiques en admirant simplement ceux et celles qui s’y exercent sans pour autant s’engager véritablement à les faire soi-même. Ce phénomène est très observable chez les jeunes, notamment chez de nombreux·se·s enseignant·e·s de matières dites littéraires, quand il faut finaliser différents rapports d’activités en dressant des statistiques mensuelles, séquentielles, trimestrielles ou annuelles. Ces personnes choisissent assez souvent de procéder par la « sous-traitance », c’est-à-dire faire faire par une tierce personne cette activité quand elles sont contraintes de les produire dans leur rapport d’activités.
De 1999 à 2015, nous avons régulièrement interrogé des élèves, des étudiants, des apprenant·e·s des centres de formation, ainsi que des personnes rencontrées dans des associations socioculturelles sur la discipline qui leur a causé plus de problèmes de compréhension et d’assimilation pendant leur cursus scolaire. Cette enquête psychosociologique réalisée auprès de plus de huit mille (8 000) personnes lettrées de différentes générations et étalée sur seize années visait à mesurer la proportion et le degré d’appréhension des mathématiques chez ces personnes. Les résultats ont révélé qu’un nombre très élevé a eu maille à partir avec le calcul, les problèmes, l’arithmétique et aujourd’hui les mathématiques. En effet, chacun y allait de ses propres raisons, pour dire et expliquer en quoi les mathématiques furent un véritable obstacle pendant leur scolarité. C’est ainsi que, sans distinction du niveau d’étude des personnes interrogées, nous avons pu noter quelques raisons pertinentes :
-
les mauvaises notes enregistrées aux évaluations;
-
la pauvreté et l’insuffisance d’encadrement des parent·e·s (avec comme corollaires le manque de manuels scolaires et les abandons scolaires);
-
trop d’exercices difficiles à faire, sans rapports visibles avec le contexte environnemental des élèves;
-
le vocabulaire et les formules difficiles à comprendre (faits de symboles et de représentations bizarres);
-
l’absence de stimulation suffisante (par les enseignant·e·s) de la pensée et de l’estime de soi chez l’élève;
-
les concepts et notions abstraits sans applications directes dans l’environnement (par exemple les espaces métriques, les notions de limite, de continuité, de convergence, de dérivation, etc.);
-
des enseignant·e·s trop pressé·e·s de finir les programmes et peu soucieux des difficultés des apprenant·e·s (avec une rigueur presque martiale pour certain·e·s et un laxiste presque déconcertant pour d’autres);
-
les méthodes d’enseignement qui ne permettent pas facilement de s’exercer quand l’on se retrouve seul·e;
-
trop de matières indépendantes sans rapports visibles entre elles.
C’est ainsi qu’environ quatre mille neuf cent deux (4 902) personnes, soit une proportion de 61,28 % d’individus a rencontré des difficultés en mathématiques à un moment donné de leurs cursus scolaire et universitaire[14]. Dans le même ordre d’idées, en 2016-2017, Inanan Kouéiwon (2018) a interrogé 150 élèves de 15 classes du lycée moderne de Yopougon-Andokoi en Côte d’Ivoire, qui devaient classer les matières dites « bêtes noires » de leur programme : « Ces matières ”bêtes noires” sont les suivantes : philosophie (25 %), mathématiques (23 %), langue (21 %), sciences physiques (14 %) » (Inanan Kouéiwon, 2018 : 107). Les résultats des deux travaux, tout en paraissant éloignés l’un de l’autre, se complètent. Non seulement les univers de travail diffèrent quantitativement et qualitativement, mais les objectifs également. Le tout pour une même finalité à savoir, montrer que les mathématiques sont parmi les « disciplines-obstacles » à franchir pour réussir à l’école.
Pour les adultes que nous avons questionnés, les réponses[15] comme celle-ci étaient légion :
Les mathématiques, avec ces techniques de raisonnement, ces expressions, ces symboles et ces formules bizarres qui n’ont rien à voir avec le concret. Je ne sais vraiment pas à quoi elles servent dans la vie, sinon à faire perdre du temps aux gens. Par ailleurs, ceux qui réussissent dans cette matière deviennent presque toujours enseignants et finissent leurs jours dans la misère et la pauvreté. En tout cas, il faut être doué pour voir clair en cette matière-là!
De ces propos, on peut dégager deux idées phares. D’une part, certain·e·s trouvent que les mathématiques sont quelque chose d’étrange et en déphasage avec la vie réelle. Elles utilisent une langue abstraite et d’un abord abscons, et le ou la mathématicien·ne lui ou elle-même ne semble pas payer de mine. D’autre part, on reconnaît une qualité positive essentielle au ou à la mathématicien·ne : il ou elle est un·e être doué·e. C’est cette situation que nous appelons le paradoxe du ou de la mathématicien·ne qui rappellerait l’image de « l’Albatros » de Baudelaire par exemple.
En réalité, ce n’est pas entièrement la faute de ces personnes qui perçoivent les choses de cette manière, car en Afrique comme ailleurs, cette discipline a souvent été dégradée et son enseignement faussé par certains individus non professionnels; ces personnes se revendiquant des courants épistémologiques mal compris, notamment les logiciens, les formalistes, les axiomatiques, les déterministes, etc., au point que les apprenant·e·s gardent le souvenir d’une discipline qui les rebute. D’ailleurs, dans le discours des jeunes scolarisé·e·s ou post-scolarisé·e·s, les mathématiques restent toujours la bête noire dans les programmes d’enseignement (Inanan Kouéiwon, 2018). Cette perception des mathématiques, qui n’a contribué qu’à présenter une image de complexité absolue et à entretenir des idées préconçues défavorables à cette discipline, semble n’avoir pas beaucoup changé dans les esprits. Les raisons de ce discrédit sont multiples et l’appétence pour les mathématiques reste d’autant moins partagée qu’il y a quelques décennies. Cette situation n’est pas une exclusivité africaine. En effet, d’après Le Cam et al. (2016), deux études menées par Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS Advanced) et portant sur les niveaux de motivation des élèves de terminale S (de 10 pays des continents américain, asiatique et européen) en mathématiques ont permis de faire des comparaisons entre l’entame et la fin de la période de 1995 à 2015. Le pourcentage d’élèves qui déclarent s’ennuyer lors des cours de mathématiques est passé de 17,9 % en 1995 à 34,4 % en 2015 dans ces pays. La conséquence immédiate est qu’on observe que la variation du niveau de motivation affecte de façon significative la psychologie et le profil de formation de ces élèves, créant ainsi une entrave émotionnelle sérieuse qui vient s’ajouter aux préjugés défavorables, déjà nombreux.
En mathématiques, les émotions sont une autre source fréquente de difficultés. Cette discipline effraie beaucoup de gens, au point qu’on parle « d’anxiété mathématique » (Ashcraft, 2002). On sait que cela peut bouleverser les stratégies cognitives et la mémoire de travail (Ashcraft & Kirk, 2001). L’anxiété mathématique est un problème important pour l’enseignement des mathématiques, et il serait bon que les scientifiques cherchent à identifier des méthodes permettant d’y remédier (OCDE, 2007 : 111).
Certain·e·s jeunes scolarisé·e·s trouvent que les mathématiques sont une discipline hermétique, difficile à cerner et loin de la réalité. Le premier contact avec les mathématiques est parfois très déconcertant pour nombre de jeunes. Ces derniers sont surpris par les premiers cours de mathématiques auxquels ils assistent, car ils s’étonnent qu’une démonstration soit encore nécessaire pour établir une proposition mathématique qui d’emblée semble évidente. C’est ainsi qu’ils éprouvent des difficultés à comprendre et développent une désaffection à l’égard de cette discipline. On débouche alors à la conclusion rapide qu’elle n’a aucune importance dans la vie courante de l’humain. Par ailleurs, d’autres, qui disent avoir abandonné l’école à cause des échecs cumulés en mathématiques, sont aujourd’hui de riches commerçant·e·s ou agriculteur·rice·s. Ces personnes dans leur épanouissement au quotidien n’envient ni l’enseignant·e d’université, ni même le/la haut fonctionnaire de l’État.
La dynamique de ces manquements, dans le contexte africain, laisse parfois entrevoir trois explications possibles :
-
soit les mathématiques, pourtant nées en Afrique il y a des siècles (Fokam Kammogne, 2000; Huylebrouck, 2005; Adjamagbo, 2009), sont devenues très hermétiques pour les Africaine·s et on ne peut rien faire contre cela;
- soit ce sont les itinéraires techniques de la discipline, c’est-à-dire ses protocoles expérimentaux et ses méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui, au fil du temps, sont marqués par des maladresses ou sont dévoyés à la base;
- soit elles sont simplement devenues une sorte de « pilule éducative » amère, rejetée par les esprits des nouvelles générations : on est incommodé par l’enseignement des mathématiques, mais on est contraint de le suivre parce qu’il est dans les programmes.
L’hypothèse d’un hermétisme qui rendrait incompréhensibles les mathématiques aujourd’hui par les jeunes Africain·e·s ne peut être qu’une réponse partielle au problème du désintérêt vis-à-vis de cette discipline. Nous pensons qu’il n’y a pas de raisons valables qui puissent justifier d’une quelconque incapacité intellectuelle des jeunes Africain·e·s à s’approprier les mathématiques qui sont considérées comme faisant partie du patrimoine du continent. Loin de nous l’idée de laisser entendre que les Africain·e·s seraient des êtres sans faiblesse. Il s’agit juste pour nous de défendre l’idée humaniste selon laquelle tous les êtres humains quelle que soit leur région sont dotés d’une intelligence potentielle qu’ils peuvent développer en fonction de leurs besoins. On ne saurait en fin de compte justifier l’échec par le caractère hermétique d’un discours scientifique dont le fonctionnement lui-même repose sur un formalisme qui ne demande qu’à être explicité.
Pour ce qui est de l’inconfort d’un certain nombre d’apprenant·e·s, il s’agit sans doute plus d’une conséquence que d’une véritable cause. Le sentiment d’ennui lors des cours de mathématiques est-il toujours lié à l’aspect hautement abstrait de la discipline? Quelle relation ce ressenti a-t-il avec le guide qui est l’enseignant·e·en face de l’apprenant·e? En répondant à ces questions, on se rend compte du rôle important de l’enseignant·e en tant que facilitateur et facilitatrice dans le processus d’apprentissage, car il lui revient de rendre simple ce qui semble complexe, concret ce qui semble abstrait. Quelles sont les notions, quels sont les concepts et outils mathématiques les plus pertinents pour favoriser chez les apprenant·e·s un meilleur apprentissage, une meilleure compréhension et une transformation du réel?
En fin de compte, l’hypothèse qui semble expliquer le mieux la situation est celle des itinéraires techniques. Le choix des stratégies, des méthodes, des démarches procédurales et de leur application semble fondamental; ils sont d’autant plus fondamentaux pour une discipline dont le haut niveau d’abstraction est reconnu de tous. Mais au-delà de ces explications sur cette représentation négative des mathématiques, il faut relever qu’à l’origine se trouvait un certain nombre de malentendus d’ordre épistémologique.
L’absence ou le peu de place accordée à l’histoire et à l’épistémologie des mathématiques. Pour Langevin, le recours à l’histoire permet d’atténuer cette impression d’une discipline figée et doctrinaire.
Ce que nous nous proposerons ici sera de mettre en évidence tout ce que l’enseignement scientifique perd à être uniquement dogmatique, à négliger le point de vue historique. En premier lieu il perd de l’intérêt. L’enseignement dogmatique est froid, statique, et aboutit à cette impression absolument fausse que la Science est une chose morte et définitive. […] Or pour contribuer à la culture générale et tirer de l’enseignement des sciences tout ce qu’il peut donner pour la formation de l’esprit, rien ne saurait remplacer l’histoire des efforts passés, rendue vivante par le contact avec la vie des grands savants et la lente évolution des idées. (Langevin, cité par Moyon, 2012 : 641)
En effet, à l’enthousiasme des bâtisseur·se·s des théories mathématiques d’autrefois, ont succédé une certaine répulsion évidente qui a tout l’air d’une démission manifeste[16] des jeunes générations face à tout ce qui représente les mathématiques. De nombreux jeunes, peu ou pas du tout préparé·e·s au raisonnement mathématique, arrivent à déconsidérer cette discipline. Des pratiques autrefois répandues laissaient entrevoir un tel abîme entre les mathématiques et le monde réel : « les mathématiques peuvent être définies comme le domaine dans lequel on ne sait jamais de quoi l’on parle, ni si ce que l’on dit est vrai. » (Russel, cité par Giudice, 2013 : 194). En fait, le formalisme très poussé des mathématiques a conduit à une coupure avec l’idée d’une vérité en tant qu’adéquation avec le monde. Les mathématicien·ne·s tiennent pour vraies des propositions ayant une validité formelle du point de vue d’un raisonnement logique. Si tout le monde s’accorde sur le degré de la rigueur du raisonnement mathématique, ces philosophes interrogent l’importance de la corrélation entre le réel et le formalisme. Mais cette conception semble réductrice dans la mesure où les mathématiques sont simplement ramenées à la logique qu’on peut considérer à juste titre comme une partie des disciplines mathématiques (Knecht, 1981).
Selon Russell (2007), comme la logique formelle, les mathématiques ne nous apportent aucune connaissance nouvelle; elles sont fondamentalement conventionnelles et une démonstration mathématique est essentiellement tautologique et fondée sur des principes admis comme indémontrables (axiomes). À travers ces observations, il pose les problématiques de démonstrations mathématiques inutilement longues qui font parfois perdre l’harmonie dans le raisonnement; de reproduction des raisonnements avec des modèles à imiter; le tout, avec pour corollaire l’encombrement systématique des bibliothèques. Des exemples illustratifs simples sont les suivants : 7 + 2 = 5 + 4 = 9 ou 3 x 4 = 2 x 6 = 12.
Pour arriver à une abstraction généralisable, on recourt à des notations du type :

Lorsque l’on observe ces différentes combinaisons d’opérations, on se rend à l’évidence que le raisonnement mathématique a consisté simplement, dans ce cas précis, à formuler et à développer quelque chose d’établi que l’on peut désigner comme étant des vérités établies, puis des vérités nouvelles.
Poincaré (1920) affirme, quant à lui, que « les mathématiques sont l’art de donner le même nom à des choses différentes. » Il précise cependant, qu’« [il] convient que ces choses, différentes par la matière, soient semblables par la forme, qu’elles puissent pour ainsi dire se couler dans le même moule. » Pour lui, « C’est à l’économie de pensée que l’on doit viser, ce n’est donc pas assez de donner des modèles à imiter. »
Autrement dit, même sans avoir désigné des objets concrets du monde (arbres, individus, instruments…), nous avons conscience que ces symboles, leurs combinaisons et les résultats de ces combinaisons sont exacts. C’est en cela que ces formes constituent des vérités. Le côté abstrait des mathématiques, ses méthodes souvent en rupture avec celles des autres sciences dites expérimentales et objets souvent désincarnés ont amené de nombreux philosophes des sciences à porter un jugement de valeur et d’utilité sur ce champ disciplinaire (Aristote, 2005 [s.d.]; Russell, 2007). La prépondérance de l’abstraction dans les mathématiques est à mettre en relation avec l’émergence, à partir du XVIIe siècle et tout au long du XXe siècle, d’un courant de pensée : le formalisme (Balibar & Macherey, 2019).
Pour les formalistes, la méthode axiomatique désigne « un mode d’exposition des sciences exactes fondées sur des propositions admises sans démonstration et nettement formulées et des raisonnements rigoureux » (Glaeser, 2019, en ligne). En d’autres termes, il s’agit de la construction d’une théorie mathématique totalement formalisée, élaborée à partir d’un ensemble cohérent de prémisses indépendantes. Ainsi, le savoir mathématique est construit conformément aux règles de la logique. Les normes qui gouvernent les mathématiques sont abstraites, cohérentes et rigoureuses. Dès lors, les rapports entre cette discipline et le réel restent questionnables.
Dans la conception axiomatique, la mathématique apparait en somme comme un réservoir de formes abstraites, les structures mathématiques; et il se trouve (sans qu’on ne sache bien pourquoi) que certains aspects de la réalité expérimentale viennent se mouler en certaines de ces formes, comme par une sorte de préadaptation. (Bourbaki, cité par Tomas, 2003 : 213)
L’axiomatique, parce qu’elle repose sur la cohérence interne des propositions mathématiques, se trouve désincarnée et exclut le recours à l’expérience. Ce qui, de ce fait, rend difficile la perception par l’humain de son utilité pratique dans la gestion de ses activités au quotidien.
Certain·e·s enseignant·e·s de philosophie et de mathématiques affirment péremptoirement, et à juste titre, que dans les pensées de ces philosophes d’autrefois, il ne s’agissait pas en première intention de bouter les mathématiques loin des préoccupations de l’homme, mais simplement d’un débat d’idées, un débat purement intellectuel à l’effet de nourrir l’esprit de sagesse et de critique positive. Dans le même ordre d’idées, Platon en son temps se moquait des « calculateurs professionnels » qui, pour lui, utilisaient la « science des nombres » non pas pour connaitre, mais pour « trafiquer ». Il dit son admiration pour les mathématiques qui permettent de
donner à l’âme un vigoureux élan vers la région supérieure [l’abstraction], et de l’obliger à raisonner sur les nombres en eux-mêmes, sans jamais souffrir qu’on introduise dans ses raisonnements des nombres visibles et palpables. (Platon, 1822-1840, v 525)
Répondant à une invitation de la régionale d’Alsace de l’APMEP, Perrin, dans sa présentation de circonstance avec pour titre : pourquoi faut-il enseigner les mathématiques aujourd’hui? explique cette perception ancienne d’une mathématique abstraite par les pratiques à la mode à cette époque.
Vous savez que les Grecs anciens (Platon, Euclide, etc.) étudiaient (et enseignaient) les mathématiques (Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre, disait Platon) et à cette époque bénie elles étaient étudiées pour des raisons philosophiques, pour la beauté qu’elles recelaient, l’harmonie qui les sous-tendait, la connaissance qu’elles permettaient d’approcher. En revanche, même si elles avaient des applications, ce n’est pas dans cet objectif qu’elles étaient étudiées (Platon se moque des “calculateurs”). (Perrin, 2004 : 11)
Lorsqu’elles sont enseignées à un public d’adolescent·e·s, sans la délicatesse nécessaire, ces postures philosophiques, du reste négativistes pour le profane, sont inéluctablement vouées à démotiver davantage ces apprenant·e·s; leur faisant croire que les mathématiques sont une matière de trop dans un ensemble de disciplines déjà trop contraignantes pour eux[17].
Les différentes interrogations issues de notre problématique, prises dans leur ensemble, débouchent, d’une part, sur le problème de l’avenir des mathématiques en Afrique et secondairement celui de la portée de l’école. D’autre part, nous interrogeons la véritable importance de cette discipline dans les activités quotidiennes de l’Africain·e qui se trouve face aux défis du savoir et de sa survie. Cette préoccupation est réelle, pertinente, mais surtout objectivement discernable aujourd’hui par toute personne avertie qui se donne la peine de regarder honnêtement les choses en face. C’est-à-dire reconnaître l’importance des mathématiques dans une société qui vise une émergence effective et durable. Nous indiquerons comment certaines sociétés, notamment les sociétés européenne, américaine et asiatique l’ont comprise et s’y attèlent au quotidien (Le Cam & Salles, 2016). Nous remarquons par exemple que de nombreux ouvrages de vulgarisation des mathématiques sont produits et ciblent prioritairement certaines catégories de lecteur·e·s. C’est le cas notamment de Dieudonné (1987) qui en commettant Pour l’honneur de l’esprit humain : les mathématiques aujourd’hui visent un public de non spécialistes.
Il précise dans son introduction :
Cet ouvrage est exclusivement destiné aux lecteurs intéressés à divers titres par la science, mais qui ne sont pas mathématiciens professionnels. L’expérience montre que presque invariablement, alors qu’ils lisent ou entendent avec plaisir des exposés sur les sciences de la nature, et ont l’impression d’en retirer des informations qui enrichissent leur vue du monde, un article sur les mathématiques actuelles leur semble écrit dans un jargon incompréhensible et traiter de notions trop abstraites pour avoir le moindre intérêt. L’objet de ce livre est de tenter d’expliquer les raisons de cette incompréhension et peut-être de la dissiper. (Dieudonné, 1987 : XX)
Dans sa thèse de doctorat, Godot (2005) propose des « situations recherche et jeux mathématiques pour la formation et la vulgarisation » de cette discipline auprès des élèves et du grand public. Dans son approche, elle met en avant l’aspect expérimental des mathématiques dans la sensibilisation à la recherche.
Greenwald & Thomley (2012), quant à elles, agissent en direction des élèves, des étudiant·e·s et des enseignant·e·s en mettant à leur disposition une encyclopédie des mathématiques et leurs interactions avec les activités sociales.
L’ Encyclopédie des mathématiques et de la société est conçue pour fournir aux élèves du secondaire et du premier cycle universitaire une source pratique d’informations sur les sciences fondamentales et les mathématiques qui sous-tendent notre vie quotidienne, expliquant aux élèves comment et pourquoi les mathématiques fonctionnent et permettant aux lecteurs de mieux comprendre comment des disciplines telles que l’algèbre, la géométrie, le calcul et d’autres affectent ce que nous faisons tous les jours. Cet ouvrage de référence académique et multi-auteurs sert de ressource générale et non technique aux étudiants et aux enseignants pour comprendre l’importance des mathématiques, apprécier l’influence des mathématiques sur les sociétés du monde entier, apprendre l’histoire des mathématiques appliquées et engager une discussion éducative suscitée par les articles sociaux et les articles sur l’actualité spécifiques présentés dans l’ouvrage.[18](Greenwald & Thomley, 2012 : vi)
Au-delà de nos expériences personnelles en situation de classe dans les structures scolaires qui ont nourri notre volonté d’écrire sur cette problématique, notre participation à des séminaires[19] a contribué au mûrissement de notre projet. L’accumulation d’informations depuis nos premières années d’étude en sciences mathématiques (1988-1993), puis pendant nos premières années d’enseignement (1994-1999) ainsi que les agissements souvent peu collaboratifs de certain·e·s collègues, de certain·e·s parent·e·s d’élève, observés çà et là, nous ont conduit à commencer la rédaction de cet ouvrage en juillet 1999. Diverses circonstances au rang desquelles nos interventions dans l’enseignement supérieur comme enseignant vacataire et notre bref séjour professionnel à l’Inspection de pédagogie en charge de l’enseignement des sciences mathématiques (2009-2012) nous ont permis de rencontrer de nombreux·e·s enseignant·e·s et élèves en situation de classe ou de recherche. Quant à notre nomination au service régional des examens, des concours et de la certification en 2013, elle nous a permis d’observer les performances sans cesse catastrophiques de nombreux·e·s candidat·e·s en mathématiques à certains examens et concours. Par ailleurs, des émissions télévisées sur des chaines comme Africa 24, TV5 Monde, Vox Africa, qui abordent les questions d’administration et de développement dans le secteur de l’éducation des pays d’Afrique subsaharienne nous ont inspiré de manière significative, de même qu’elles nous ont décidé à concrétiser notre projet. Il est évident que nous aurions pu peaufiner encore et toujours notre argumentaire, décrire davantage les faits en ajoutant des idées nouvelles si nous l’avions publié deux ou trois années plus tard. En effet, nous aurions fait face à la même situation ou presque parce que le sujet fédérateur qui nous préoccupe ici est très actuel, complexe et délicat à la fois. Il mérite par conséquent d’être examiné avec dextérité.
Un autre élément de motivation est bien évidemment le développement et la disponibilité aujourd’hui d’outils de plus en plus modernes grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est ainsi que plusieurs cours sur une même théorie, sur des sujets isomorphes d’une discipline, provenant d’enseignant·e·s différent·e·s et appartenant à des établissements tout aussi différents, sont désormais disponibles en ligne et accessibles à tous; gratuitement pour certain·e·s, soumis à une obligation d’abonnement internet pour d’autres. De nombreuses sociétés de téléphonie mobile offrent d’ailleurs divers services dans ce sens sur le marché. Un·e apprenant·e qui rencontre des difficultés sur un sujet peut désormais à travers un simple téléphone portable accéder à un document (livre, article…), suivre un cours par vidéo, échanger sur des questions de cours avec des camarades ou des enseignant·e·s. En effet, toute recherche scientifique a un coût. Mais en mathématiques, fort heureusement, ce coût est un peu moindre et l’activité ouvre à d’opportunités diverses et variées. Cet avis est également partagé par des auteurs et des autrices comme Flato (1990), Makrides (2012), ainsi que Greenwald & Thomley (2012).
Étant nous-mêmes le produit d’un système éducatif africain, il serait inapproprié de ne pas compter, au rang des motifs incitatifs, le fait qu’en Afrique particulièrement, les domaines prometteurs de la recherche en mathématiques et dans les disciplines apparentées sont pluriels. Les sujets de recherche sont autant riches et diversifiés que d’actualité. Cependant, pour des raisons multiples relatives aux modèles sociétaux propres à l’Afrique, les besoins en termes d’acteurs et d’actrices restent toujours très grands aussi bien dans l’enseignement supérieur (IMU, 2009) que dans l’enseignement secondaire[20].
Pour atténuer l’ampleur de ce problème d’insuffisance du personnel enseignant au secondaire, plusieurs pays d’Afrique membres de la CONFEMEN ont établi de nouvelles politiques de recrutement du personnel enseignant, soit l’embauche de non-fonctionnaires, tels que des volontaires et des vacataires. Par exemple, au Tchad, les enseignants communautaires sans qualification représentent 50 % du personnel enseignant. Quant au Bénin, 83,3 % des enseignants du secondaire sont non permanents. (CONFEMEN, 2008 : 34)
Les universitaires africain·e·s de premier rang parmi lesquels les enseignant·e·s, les ingénieur·e·s et autres chercheur·e·s du terroir comme de la diaspora doivent avoir en conscience ce défi d’une veille mathématique sur le continent. Ils et elles doivent amener la jeunesse africaine à un niveau de travail qui cadre avec les exigences de cette discipline et les encourager à rattraper leurs semblables qui sont suffisamment avancés en la matière dans d’autres parties du monde (Traoré & Barry, 2007; Sokhna & Sarr, 2009).
C’est pourquoi les pouvoirs publics et les gestionnaires des systèmes éducatifs des pays africains doivent œuvrer, avec le concours des membres de la communauté éducative (les parent·e·s, les enseignant·e· s, les responsables administratifs et les autres partenaires techniques et financiers du monde éducatif, notamment les acteurs opérant dans le secteur privé et les ONG), pour ramener les jeunes à la raison afin de leur expliquer de manière efficiente la véritable portée de cette science; ceci non seulement pour la réussite scolaire, mais aussi et surtout pour une réussite sociale à travers une insertion définitive dans le monde socioprofessionnel. Il va sans dire que cette opération de conscientisation ne devra en aucun cas négliger le rôle des autres disciplines enseignées. Il est vrai qu’on rencontre une quantité importante de jeunes qui sont admiratifs devant leurs camarades qui ont réussi dans les spécialités ayant une forte proportion de mathématiques. Mais ces enfants semblent toujours « impuissant·e·s » devant les difficultés à apprendre du fait, pour une partie, d’un encadrement insatisfaisant. Nous ne pouvons pas immédiatement dire que tous et toutes ignorent que les mathématiques sont utiles et permettent de faire de « grandes choses ».
Toutefois, nous pensons que l’ignorance ou le refus à dessein de reconnaitre les valeurs et les pouvoirs de cette discipline, à la fois sur les plans vertical et transversal[21], par un pan important des élites d’une société humaine participe des phénomènes d’échec et de décrochage enregistrés dans les filières mathématiques et apparentées, au sein de cette société. Dans le même ordre d’idées, les conséquences engendrées par l’ignorance ou la déliquescence, par une volonté humaine, des connaissances d’une manière générale, et observables sur le terrain en termes d’incivisme généralisé des jeunes, de disparition des modèles sociétaux ou de la paupérisation des valeurs sociétales, sont suffisamment importantes et nécessitent d’être examinées.
Quelques facteurs explicatifs de l’échec en mathématiques
De nombreux paramètres sont à prendre en compte lorsque l’on veut expliquer l’échec constaté chez les apprenant·e·s à la fois en classe de mathématiques et dans les filières mathématiques. Nous les regroupons en deux grandes catégories selon qu’ils prennent leurs sources à l’intérieur du système éducatif ou qu’ils proviennent des éléments extérieurs à ce système. Au début de l’année 2020, un élément inattendu, extérieur au système et sujet à de nombreuses controverses fait son apparition : la maladie à coronavirus (Covid-19). Cet élément a perturbé l’année scolaire par la fermeture complète de tous les établissements scolaires, universitaires et les autres structures d’éducation et de formation en présentiel. Nous nous devions alors de mesurer son impact sur les résultats scolaires. C’est ainsi qu’au regard des chiffres de 2020 relatifs aux performances des candidat·e·s en mathématiques à l’examen BEPC, indiquant un taux de réussite de 3,96 % sur un échantillon de 3 988 candidat·e·s (copies des candidat·e·s, salles de correction, nombre d’établissements…), nous constatons qu’au Kamerun comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, après plus de quatre mois (de mi-mars à mi-juin) de confinement partiel, le niveau de performance en mathématiques des élèves candidat·e·s au BEPC est resté presque constant : 4,42 % en 2015, dans une situation normale sans incident important. Il s’agit là d’un indice à retenir[22]. Les raisons fondamentales pouvant justifier l’échec dans cette matière pourraient se trouver bien au-delà de la qualité des activités de classe en présentiel, mais elles proviennent aussi et surtout de l’intérieur même du système éducatif.
Facteurs endogènes au système éducatif
Il s’agit des facteurs liés essentiellement à la gestion du système éducatif avec notamment la qualité des infrastructures, les ressources humaines, les programmes d’enseignement, la pédagogie de communication, de l’enseignement-apprentissage et l’expérimentation des mathématiques (Godot, 2005).
Le cadre structurel de l’enseignement et de l’apprentissage
Le décrochage scolaire, et partant l’échec en mathématiques est imputable à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer :
-
les difficultés d’accès à un bon encadrement : les élèves des zones rurales sont très souvent enseigné·e·s par des non professionnels;
- l’organisation du travail par l’administration scolaire : les enseignant·e·s, qui sont déjà en nombre très insuffisant, sont pour la plupart submergé·e·s de travail et ne peuvent pas consacrer suffisamment de temps à chacun des apprenant·e·s comme on l’aurait souhaité;
- l’image négative attachée à cette discipline et répandue au sein d’un pan important de la société;
- la méconnaissance de l’impact direct ou indirect de cette discipline dans la gestion quotidienne des activités de tout homme en quête du mieux-être;
-
une insuffisance d’initiatives d’émulation et de motivation à la fois chez les apprenant·e·s et les enseignant·e·s. Par exemple, l’emploi des critères peu rigoureux qui occultent le mérite comme outil de gouvernance scolaire et sociale est un choix très questionnable.
-
les innombrables insuffisances qualitatives et quantitatives au niveau des équipements éducatifs, du matériel didactique, des infrastructures éducatives d’accueil (Greenwald & Thomley, 2012 : 28-31).
S’agissant de ce dernier facteur, le CONFEMEN l’évoque avec plus de détails et ajoute en même temps l’inadéquation entre les curricula et le matériel didactique dans certains pays.
L’état des lieux nous permet également de constater un déficit important de matériel didactique, dont les fournitures et les manuels scolaires. Non seulement les manuels sont rares au sein des écoles secondaires africaines, particulièrement dans les zones rurales, mais ils sont aussi mal partagés et mal gérés (volés, altérés, etc.), de sorte que le ratio livres/élève est bas. De plus, dans certains pays comme le Togo, une inadéquation entre les curricula et le matériel didactique est observée. (2008 : 41)
Par ailleurs, certain·e·s jeunes scolarisé·e·s manquent de livres de mathématiques au programme; d’autres n’ont pas du tout accès aux manuels de mathématiques pour diverses raisons : défaut de librairie dans leur localité et de bibliothèque dans leur établissement, prix relativement élevé du manuel sur le marché…
Comme le relève Perrin, l’on note également chez les enseignant·e·s du secondaire comme chez ceux et celles du supérieur, le peu d’intérêt accordé aux autres disciplines et une tendance à figer le mode de raisonnement lors des apprentissages.
Mais il y a aussi des points qui sont de notre ressort et qu’il est essentiel de prendre en compte. Je voudrais en citer deux.
D’abord, je crois que nous devons prêter plus d’attention que nous ne le faisons aux autres disciplines. Pour montrer que les mathématiques sont utiles, nous devons accorder plus de place dans nos enseignements aux activités de modélisation (et les discuter!). C’est ainsi que nous pouvons convaincre les autres, tous les autres, de l’importance des [sic] mathématiques.
Ensuite, s’agissant de l’apprentissage du raisonnement, il est important de ne pas le réduire à celui de la démonstration qui tourne souvent à l’exercice de style et dans lequel de nombreux élèves ont de la peine à rentrer. Il y a deux conditions pour cela. La première est de ne pas craindre d’étudier des problèmes ouverts (par exemple, en géométrie, les problèmes de lieux ou de constructions). La seconde est de disposer des bons outils pour faire des mathématiques. Par exemple, en géométrie encore, on peut penser que l’outil de transformations n’est pas le mieux adapté au niveau du collège et qu’il serait plus pertinent de lui préférer l’usage des invariants et des cas d’isométrie ou de similitude des triangles. (Perrin, 2004 : 20)
Certain·e·s jeunes, déçu·e·s par de mauvais résultats scolaires, découragé·e·s par des mathématiques trop exigeantes et contraignantes pour elles et eux, mis·e·s sous pression par certain·e·s enseignant·e·s qui ont maille à partir avec la pédagogie, abandonné·e·s à eux-mêmes et elles-mêmes par des parents trop occupé·e·s à autres choses, quittent l’école formelle pour entrer à l’école informelle ou s’installer dans la débrouillardise; une sorte de jungle humaine que les sociétés, mêmes modernes, n’ont toujours pas pu se défaire.
Aux raisons qui expliquent la désaffection des jeunes pour les mathématiques, Perrin en ajoute deux autres.
Il y a sans doute à cela des raisons sociales auxquelles nous sommes essentiellement étrangers : le statut de discipline dominante et de discipline sur laquelle se faisait la sélection a beaucoup nui aux mathématiques. De même, le développement de l’informatique, qui permet de faire sans peine des calculs autrefois réservés aux experts, a pu faire croire que les mathématiques étaient devenues inutiles. (Perrin, 2004 : 20)
Sur le plan de la discipline en milieu scolaire, à force d’observer les comportements de plus en plus désorientés des jeunes et leurs moralités de moins en moins bonnes dans les formations scolaires, universitaires et même socioprofessionnelles, on a l’impression que la discipline qui fait partie de l’éthique et l’apprentissage des mathématiques ne sont pas compatibles. Un pan non négligeable de la jeunesse africaine actuelle est durement critiquable du fait de son penchant pour une délinquance marquée par la désobéissance, l’incivisme, la corruption[23], etc. Ces comportements déshonorants, de déviance et de marginalité, entretenus par quelques-uns en son sein, sont-ils de nature à favoriser l’éclosion des sciences en général et des mathématiques en particulier dans leur milieu? Ces jeunes au rang desquels de jeunes inadaptés et de jeunes délinquants vrais devenus incontrôlables, quand ils sont interpellés par l’administration scolaire ou la police, s’organisent à résister face aux enseignant·e·s, parent·e·s et même la société entière qui, n’ont pas su, en temps opportun, leur indiquer les attitudes à adopter en tant que membres d’une communauté établie dans un environnement anomique[24] en profonde mutation (Poitou, 1981; Demba et al., 2020). Une mutation manifeste dans un contexte d’inégalités et de violences, qui au demeurant, n’épargne pas la vie familiale et psychologique.
Une bonne part des comportements déviants résultent des conduites anomiques, témoignant de l’absence de normes consécutive à la déstructuration du groupe familial ou à l’éclatement de la cellule conjugale. (Poitou, 1981 : 114)
Cette déstructuration de la cellule familiale, plus observable en milieu urbain, vient renforcer le rôle déjà néfaste des conditions de la scolarisation dans le développement de la délinquance vraie dans ce milieu. La scolarisation à outrance (avec la multiplicité des institutions scolaires privées hors normes) semble très mal adaptée, étant donné la qualité de ses produits sur le marché de l’emploi, à la réalité africaine au sud du Sahara. Les « métis culturels » qu’elle génère paraissent à la fois déracinés et impuissants à s’intégrer dans le circuit économique moderne, faute de qualification adéquate et de débouchés suffisants (Poitou, 1981). Dans les zones urbaines, la présence quasi systématique des points de loisirs à proximité des institutions scolaires développe chez les apprenant·e·s un faible pour des fléaux tels que l’alcoolisme, la toxicomanie, la prostitution, le proxénétisme, les jeux de hasard, etc., gages des comportements déplacés et répréhensibles. Le passage de la délinquance primaire sans réelle gravité à une délinquance vraie est désormais plus facile.
Les causes véritables de la délinquance, toutes et étant complexes et contrastées en qualité comme en quantité, sont la résultante des conditions structurelles essentielles imposées par une situation d’anomie, consécutive à des changements sociétaux assez rapides et face auxquels les jeunes ont de la peine à s’adapter.
Les principaux facteurs de délinquance sont à rechercher d’abord dans la situation économique et dans les problèmes de la famille, dans les insuffisances du système scolaire et dans les frustrations créées par les conditions d’urbanisation des nouveaux citadins. (Poitou, 1981 : 122)
Le problème se pose aujourd’hui avec acuité, car les agents primaires de socialisation de l’enfant, à savoir le groupe familial et le système éducatif, ne sont plus capables de remplir entièrement leur fonction d’encadrement. C’est ainsi qu’une recrudescence des violences individuelles et collectives est enregistrée dans les milieux scolaires. Ce phénomène se manifeste par de multiples refus de respect et transgressions des règles sociales établies au sein des institutions scolaires et consignées dans un document spécial dénommé règlement intérieur. Feuzeu (2020) s’appuyant sur six (6) cas atypiques de violences recensés dans des établissements scolaires au Kamerun sur une période de quatorze (14) mois, observe une cristallisation des violences en milieu scolaire dans ce pays, avec des causes variées et la responsabilité des acteurs et actrices partagées.
À voir de près, les actes incriminés sont perpétrés par divers acteurs. On dénombre les délinquants venus de l’extérieur de l’établissement, les élèves, les enseignants, les parents d’élèves, les hommes en tenue, l’administration scolaire et même l’autorité administrative. (Feuzeu, 2020 : 2136)
Des actes d’incivilité, agressions et accrochages sont fréquents entre les jeunes scolarisé·e·s ou non; et ce sont les enseignant·e·s et/ou les parent·e·s qui en payent parfois les frais[25]. Ce genre de fait divers qui vient souvent perturber la quiétude des apprenant·e·s pourrait influencer directement ou indirectement les enseignements ou les performances en mathématiques de ceux ou celles-ci, surtout quand il survient entre deux ou plusieurs élèves, en salle de cours ou en dehors, pendant une leçon ou une évaluation de mathématiques. Le petit moment d’arrêt d’activités qui, en pareille circonstance, s’impose généralement aux acteurs didactiques en présence leur fait perdre un peu le fils de leurs idées.
En outre, s’agissant de la délinquance authentique, aujourd’hui dans les milieux carcéraux, la majorité des individus en détention provisoire ou préventive prolongée se recrute parmi les jeunes y compris les adolescents. Le cas des pays africains situés au sud du Sahara comme le Niger et le Nigeria (Poitou, 1981), le Gabon (Demba et al., 2020), le Kamerun (Feuzeu, 2020) et notamment celui de Madagascar est assez typique.
Dans les pays d’Afrique subsaharienne, la détention provisoire est utilisée de manière excessive et à titre de châtiment. En juin 2019, 28 045 personnes étaient détenues dans les prisons de Madagascar, qui dispose d’une capacité nationale totale de 10 360 places. Plus de 75 % des 977 adolescents détenus se trouvaient en détention préventive. (Muchena, 2020, paragr. 5)
Dans les milieux scolaires, un nombre non négligeable de jeunes garçons et filles, quand ils ou elles ne s’autocensurent pas en abandonnant l’école ou les cours de mathématiques volontairement, ils ou elles sont souvent, pour diverses raisons, exclu·e·s temporairement ou définitivement des établissements avant même la fin de l’année scolaire[26]. Et quand parmi ces présumé·e·s délinquant·e·s figurent un·e élève qui travaille mieux en mathématiques en classe, le groupe de travail dont il ou elle faisait partie connaîtra inéluctablement un vide dû à son absence. Toutefois, d’autres élèves se montrent plus entreprenant·e·s dans les activités post et périscolaires. Ici encore, les taux d’adhésion dans les clubs à caractères scientifique et technologique restent très faibles, presque dans les mêmes proportions que les taux d’inscriptions dans les filières correspondantes. Les jeunes ne semblent-ils/elles pas plus intéressé·e·s par le sport, la danse, les voyages et les clubs de photographie ou des amis invisibles? Il s’agit des milieux dans lesquels ils ou elles mènent des activités qui, pensent-ils ou elles, n’ont rien à voir avec les mathématiques et ses exigences.
Sans toutefois effectuer un travail de sociologue, il nous semble opportun de souligner un fait social qui pourrait sans doute exercer une influence quelconque avec le sujet qui nous préoccupe. Ce fait se traduit par ce que nous appelons jeunesse de façade politicienne. Il s’agit de cette catégorie de jeunes qui nait et se développe aux côtés des archétypes socioéducatifs. Des jeunes Africain·e·s qui, sans être militant·e·s, se regroupent dans des mouvements ou autres associations à caractère socioculturel et/ou politique, à l’effet de soutenir un leader social, modèle de leurs rêves. Ces jeunes qui désertent pour des raisons diverses les milieux scolaires et universitaires pour rentrer, soit dans ces sortes de « fans clubs », soit dans la rue, ne se livrent-ils/elles pas à toutes formes de déviances qui sont susceptibles de compromettre leurs performances scolaires ou universitaires, et par suite leur avenir? D’autres s’investissent soit dans les salles de jeux de hasard, gaspillant de l’argent reçu ou dérobé subtilement à leurs proches ou parent·e·s, soit ils ou elles se livrent à la petite délinquance, décourageant et déroutant ainsi certain·e·s parmi leurs pairs qui n’aspirent qu’à aller normalement à l’école. Les conséquences de ce fait sont rattachables aux causes des échecs de la jeunesse, dans divers secteurs y compris l’école moderne et « ses » mathématiques.
Aujourd’hui, les jeunes trouvent leurs modèles et leurs idoles en dehors des secteurs d’activités qui nécessitent un certain type d’intellect. C’est ainsi qu’un nombre important de jeunes s’intéresse davantage aux sports, à la musique ou au cinéma, multipliant des challenges dans ces domaines; ceux-ci, à quelques exceptions près, brassent beaucoup d’argent et font régner le principe du pot-de-vin. Beaucoup sont sollicités à temps partiel par de grandes firmes commerciales pour participer à des ventes promotionnelles de certains produits, à des caravanes et autres spectacles interminables de musiques au cours desquels les jeunes filles et garçons sont souvent soumis à toutes formes de harcèlements. Notre propos n’est pas de dire que les métiers de divertissement sont dépourvus de valeurs, mais plutôt de questionner les choix, les profils et les motivations qui conduisent les jeunes à embrasser de telles activités (Sako, 2010). Si l’on interroge ceux-ci et celles-ci sur leur projet de vie, ils sont très peu à vouloir porter leur premier choix sur ces métiers. Beaucoup y vont par mimétisme et se retrouvent souvent piégé·e·s. Il faut toutefois noter que la précarité dans laquelle certain·e·s jeunes se retrouvent ne leur laisse pas beaucoup d’options. Ils doivent pouvoir affronter de telles difficultés et aller de l’avant.
Dans nos écoles, l’on constate facilement qu’un certain nombre de jeunes font les mathématiques sans engouement, simplement parce que tel qu’elles sont enseignées, elles n’exercent pas d’attrait sur ces enfants; elles leur semblent imposées par le système. Pour ceux et celles qui s’en sortent mieux en mathématiques, des automatismes de calcul s’installent au cours de la pratique régulière des exercices, leur permettant de construire des schémas de problèmes. Tout se passe comme si l’apprenant·e et l’enseignant·e avaient construit chacun et chacune une mémoire des problèmes déjà rencontrés, ainsi que des savoir-faire de résolution associés. Cette forme de mémoire s’organise grâce à un certain catalogage et un recours à des problèmes prototypiques représentatifs de chaque catégorie de problèmes déjà rencontrés. L’apprenant·e peut alors être capable de mobiliser à bon escient le modèle le plus adapté pour résoudre le problème posé lors d’une évaluation de connaissances ou de compétences. Bien que ce soit positif, l’élève développe le plus souvent des itinéraires techniques, c’est-à-dire des procédures toutes faites sans originalité particulière, héritées d’un système éducatif visant essentiellement à rappeler, restituer les connaissances acquises plutôt qu’à penser parfois autrement face à des problèmes fussent-ils isomorphes (Van Nieuwenhoven, 2014).
Ainsi, nous avons pu observer que des éléments tels que la qualité des infrastructures, des enseignant·e·s, les méthodes d’enseignement/apprentissage et d’encadrement des apprenant·e·s, ainsi que les types d’évaluation sont susceptibles d’affecter négativement la réussite scolaire, particulièrement en mathématiques. Sur les trois derniers éléments sus-cités, la CONFEMEN fait observer qu’
en Afrique subsaharienne, le nombre d’enseignants qualifiés est insuffisant pour répondre à la demande croissante des établissements d’enseignement secondaire provoquant ainsi l’embauche massive d’enseignants sans formation adéquate. (2008 : 41)
Cependant, il existe des éléments relevant notamment du dispositif d’enseignement/apprentissage qui contribuent à une situation d’échec : les leçons de mathématiques de certain·e·s enseignant·e·s titulaires, qualifié·e·s et non qualifié·e·s, permanent·e·s ou vacataires semblent encore et toujours en rupture avec les autres activités de la classe, non contextualisées et dépourvues de liens interdisciplinaires. Ce qui conduit, assez souvent, à une ambiance de classe particulière, faite d’exigences, de méthode, d’ordre, de rigueur, de vocabulaire, de langue et de métalangue. Dès lors, les mathématiques représentent, aux yeux des apprenant·e·s, un domaine réservé, engendrant par la même occasion des comportements de rejet; attitude dont il devient difficile de se défaire à la longue.
Des indicateurs de performances médiocres
Les jeunes en âge scolaire au Kamerun comme dans plusieurs pays d’Afrique (CONFEMEN, 2008) renoncent, dans leur majorité, aux disciplines et secteurs socioprofessionnels dont la formation initiale exige une réflexion mathématique, aussi petite soit-elle, pour embrasser des filières qui, pensent-ils, n’ont rien à voir avec cette matière. D’après Berger (2005), Le Cam & Selles (2016), cette fuite de la jeunesse en âge scolaire, couplée aux échecs enregistrés dans cette discipline est assez notoire dans la plupart des pays africains subsahariens, et même dans certains pays en voie d’émergence. Ces indicateurs reviennent dans divers aspects sociaux en relation avec l’éducation en général. L’UNESCO, dans son Rapport mondial de suivi sur l’EPT[27] de 2005, donne quelques chiffres assez parlants (Pilon, 2006). Pour ce qui concerne les taux de renonciation et d’échec en mathématiques, par exemple, la situation reste préoccupante. Sur le terrain, et en situation de classe notamment, il y a une sorte d’inertie qui caractérise très souvent les séances de leçons ou de travaux dirigés de mathématiques. Il y a également la persistance des difficultés liées à la bonne connaissance des outils fondamentaux en mathématiques par les apprenant·e·s et certain·e·s enseignant·e·s[28]. Dans l’optique d’agir positivement sur ces indicateurs, plusieurs travaux sont conduits quotidiennement dans divers laboratoires de recherche en science de l’éducation depuis des décennies. Le thème fédérateur de ces travaux de réflexion concerne essentiellement l’amélioration des programmes, des enseignements, des apprentissages et la pratique des mathématiques en Afrique.
Pour Touré par exemple, les pays francophones doivent :
non seulement préparer leurs citoyens à comprendre et appliquer les mathématiques dans la vie de tous les jours, mais aussi, assurer la formation des mathématiciens utiles à leur développement économique, scientifique et technologique. (2002 : 6)
La solution proposée par Traoré & Barry, est de partir d’une distinction fondamentale :
il existe des problèmes isomorphes (au sens des mathématiciens) dont les solutions diffèrent considérablement selon qu’ils sont posés en contexte scolaire ou en contexte de la vie quotidienne. (2007 : 3)
Enfin, Sokhna & Sarr ont proposé dans le cadre de l’Université virtuelle africaine de capaciter les enseignant·e·s de mathématiques en concevant des dispositifs de formation continue et à distance, ainsi que des ressources susceptibles de les aider dans leur profession. Ils inscrivent leur projet dans une dynamique qui ferait passer d’une « formation d’enseignants aux mathématiques » à une « formation d’enseignants de mathématiques » (2009 : 1). En d’autres termes, il est question d’amener les enseignant·e·s de mathématiques à réfléchir sur leurs pratiques d’enseignement-apprentissage-expérimentation et à concevoir des outils pédagogiques efficaces de sorte qu’on assiste plus à une simple juxtaposition d’automatismes coupés de la réalité. De manière globale, les résultats de ces travaux sont des œuvres partagées par une catégorie d’enseignant·e·s de mathématiques pétri·e·s d’expériences africain·e·s ou non, des inspecteurs et inspectrices de pédagogie, des chercheurs et chercheuses en science de l’éducation (Godot, 2005 : 137-212) et autres formateurs et formatrices chevronné·e·s faisant dans la formation initiale et continue des enseignant·e·s du primaire et du secondaire, et par quelques chercheur·se·s en didactique.
Dans les programmes actuels d’enseignement des mathématiques du secondaire de la plupart des pays africains, il ne figure pas de contenus explicites, aussi réduits soient-ils, sur l’histoire de cette discipline ni sur celle de ses diverses théories. Au Kamerun et à l’université de Ngaoundéré par exemple, un cours d’épistémologie des sciences a été supprimé des programmes d’enseignement du département des mathématiques et d’informatique de la faculté des sciences dans les années 2010. Dans les écoles normales supérieures, quelques thèmes sur le caractère transversal et l’interdisciplinarité des mathématiques avec d’autres sciences sont timidement abordés par des élèves-professeur·e·s de mathématiques dans leurs mémoires de fin de formation (Kono, 2014). Pourtant, les mathématiques, comme les autres sciences, sont une construction, une culture qui se perfectionne au fil de l’histoire et du temps. L’enseignement de l’histoire des mathématiques apporte une dimension culturelle indéniable aux processus de transmission et d’acquisition des savoirs de ce champ disciplinaire. Il permet à l’apprenant·e d’affronter les incertitudes « mathématisables » ou non avec beaucoup plus de conviction.
Certains étudiants peuvent avoir le sentiment que cet enseignement est inutile, car il ne donne pas un accès immédiat aux théories mathématiques modernes et efficaces. Cela est vrai, mais après tout, les mathématiques paraissent elles aussi souvent inutiles. Le but d’un enseignement d’histoire des sciences et de culture scientifique est le même que celui d’un enseignement de sciences traditionnel : il permet de transmettre l’expérience de nos prédécesseurs. L’histoire permet de prendre du recul par rapport aux évènements immédiats; la culture permet d’avoir des repères. (Baumann, 2004-2005 : 10)
L’utilisation d’éléments d’histoire des mathématiques dans l’enseignement en classe comme dans la formation initiale et continue des enseignant·e·s ne peut se faire qu’à travers une didactique des mathématiques adéquate (Clinard, 1993). Il n’est pas toujours aisé de se les approprier, de les maîtriser ou de les assimiler sans se remettre en question (Villani, 2010). Et la remise en question parait impérative pour tout type de discours qui se veut scientifique. À ce propos, Bachelard ne disait-il pas qu’« on connait contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites. » (1398 : 14)?
Par ailleurs, l’inadéquation entre les profils des élèves et les épreuves auxquelles ils et elles sont soumis·e·s lors de certains examens et/ou concours pose un véritable problème d’ordre pédagogique. Au Kamerun par exemple, les effectifs réduits au second cycle des lycées d’enseignement technique pourraient résulter du fait que le faible nombre d’élèves titulaires d’un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) venant des premiers cycles du même ordre d’enseignement est obligé de passer un concours pour accéder au second cycle, au même titre que ceux et celles qui viennent de l’enseignement général. Paradoxalement, l’on constate, pour le déplorer, que parmi les épreuves écrites de ce concours ne figure aucune épreuve de matières professionnelles. Elles se limitent exclusivement aux trois matières que sont le français, l’anglais et les mathématiques. C’est ainsi qu’un nombre important de jeunes titulaires d’un CAP qui pour la plupart ne sont pas souvent brillants dans les matières d’enseignement général, et qui sont refusé·e·s, se retrouvent abandonné·e·s à leur sort et obligé·e·s de se lancer sans expérience dans la vie active ou dans la débrouillardise. Est-ce cette catégorie de technicien·e·s qui permettra à l’Afrique d’atteindre l’émergence? Une pédagogie différenciée aurait pu distinguer les profils et trouver des dispositifs d’évaluation (étude des cas ou des projets) qui soit en corrélation avec les spécialités, les prérequis et les préacquis de chacune des catégories de candidat·e·s à ce concours.
En outre, quel intérêt tire-t-on à présenter des statistiques équivoques aux examens certificatifs, avec à terme, à défaut du statu quo, plutôt qu’une dégénérescence généralisée et progressive de la vie scolaire et postscolaire dans presque tous les secteurs d’activités de la communauté?
Facteurs exogènes au système
Parmi les raisons explicatives de l’échec en mathématiques en milieu d’apprentissage, il y en a qui sont extérieures au système éducatif, notamment un certain nombre de représentations et d’attitudes tendant à freiner les esprits, ainsi qu’une adéquation insuffisante à la fois des méthodes et des apprentissages au contexte purement africain dont les potentialités ne sont pas mises en avant.
Des pesanteurs systémiques sur le continent africain
Sans être exhaustif, les possibles pesanteurs non moins négligeables que connaissent les développements socioéducatif, économique et intellectuel de l’Afrique sont de plusieurs ordres :
Les marques profondes de la traite et de l’esclavage négriers transatlantiques ont arraché à l’Afrique noire ses valeurs et ressources humaines les plus valeureuses sur les plans à la fois intellectuel, physique et psychologique; laissant ainsi présents dans les esprits et les cœurs des Africain·e·s de multiples victimisations et des conséquences indélébiles et intergénérationnelles. Les séquelles actuelles telles que « la faible confiance en soi, la faible estime de soi, la hiérarchie de la couleur, le racisme interne. » (Tagodoé, 2011 : iii) dont souffrent les Afro–descendant·e·s seraient à l’origine d’un trauma congénital : « le syndrome ou trouble post-traumatique découlant de l’esclavage. » (Tagodoé, 2011 : 1-2). Le pressentiment de Tagodoé nous semble un peu excessif, questionnable et mérite d’être pris avec beaucoup de réserves. En effet, pour lui, des jeunes d’Afrique d’aujourd’hui connaitraient des difficultés en mathématiques parce qu’ils et elles sont l’objet d’un trouble post-traumatique issu de l’esclavage. Nous pensons que non! On ne peut pas expliquer rigoureusement les problèmes de la société africaine contemporaine par le recours à des faits historiques aussi lointains. Les Africain·e·s doivent avec plus de sérieux agir sans complaisance pour la construction de leur destin en dépassant ce genre de frustrations combien dévalorisantes pour la personne humaine.
L’Afrique est un continent anciennement ouvert au monde, mais toujours resté à la traîne dans presque tous les domaines porteurs de développement. De même, de longues années de famine, de maladie et de guerres renouvelées avec pour corollaires l’insécurité alimentaire, sanitaire et éducative : il y a encore des poches visibles et permanentes de la famine, des maladies (paludisme, sida, Ebola, etc.) et de la sous-scolarisation çà et là sur le continent. En plus, l’instabilité géopolitique : l’absence d’une paix permanente couplée à l’instabilité politique dans de nombreux pays. On observe des coups d’État récurrents, une insécurité permanente, des institutions politiques peu stables, la fuite des cerveaux et l’exode des jeunes vers d’autres horizons. La fuite des cerveaux qui engendre l’exode des ressources humaines aux qualités intellectuelles avérées s’est accentuée au fil du temps. Cependant, des pistes de solutions à cette dynamique sociale d’envergure existent (Gaillard A. & Gaillard J., 2006).
Dans une approche naïve, le lecteur peut se demander quelles relations l’apprentissage des mathématiques peut entretenir avec la traite négrière, la famine ou l’instabilité politique. Notre démarche vise à prendre l’enseignement/apprentissage des mathématiques comme un élément constitutif d’une société qui doit garantir dans son ensemble des conditions d’éclosion, de développement et de rayonnement des formes de savoirs et de savoir–faire. En effet, comment envisager une réussite à la fois intellectuelle et sociale dans un contexte où règnent des frustrations, des préjugés, des maladies, de l’instabilité en toute chose, etc.? Notre propos est de dire que le visage que présente le continent africain actuellement n’est pas propice à son propre développement global. Des auteurs comme Vergnaud (1982) et Vellard (1988) n’ont-ils pas montré l’importance des facteurs psychologiques et cognitifs dans le processus d’apprentissage?
On observe un continent profondément inégalitaire et dépendant. L’accès à une bonne structure d’éducation en Afrique par la majorité des jeunes Africain·e·s est très difficile, voire différencié; les inégalités sociales sont facilement perceptibles.
L’Afrique reste l’une des régions du monde dans laquelle les inégalités sont les plus marquées, étant donné qu’elle abrite 10 des 19 pays les plus inégalitaires de la planète. Les niveaux d’inégalité élevés à travers le continent posent un sérieux défi à la réalisation de l’objectif primordial de « ne laisser personne de côté » à l’horizon 2030. (Odusola, Cornia, Bhorat & Conceição, 2017 : 23)
Par ailleurs, la très insuffisante audibilité de la pensée africaine[29] constitue un véritable frein. Consécutive au néocolonialisme, cette audience lacunaire, pour de nombreux auteurs et autrices, est entretenue par des dispositifs inéquitables de production et de diffusion des savoirs. C’est ainsi que Piron parle d’une invisibilisationde certaines catégories de savoirs : « Au cours de mes recherches, j’ai découvert à quel point les savoirs des acteurs étaient pris dans les formes de pouvoir qui pouvaient invisibiliser d’autres formes de savoirs notamment ceux des femmes et ceux des pays du Sud. » (2019, en ligne). Cette action préjudiciable à la diversité des formes de savoirs aboutit le plus souvent, comme le montre d’ailleurs Piron, à une négation de la pensée des autres : « On nie la singularité des auteurs qui souffrent de ne pas pouvoir agir dans la société à travers leurs recherches et qui ne finissent par [sic] ne plus voir leurs responsabilités sociales. Or, un chercheur est toujours situé dans une langue, un pays, un genre, une histoire. » (2019, en ligne). Ce sont des écueils majeurs à l’expression de la pensée africaine.
Dans la même logique, à l’observation des politiques de relations internationales et de développement agricole adoptées par plusieurs pays de l’Afrique francophone au lendemain des années 60, Dumont en visionnaire mettait déjà en garde cette partie du continent africain, à travers un premier cri d’alarme dans son célèbre ouvrage, L’Afrique noire est mal partie (1962). En effet, dans une analyse assez critique des sociétés africaines qui tranche avec les considérations géopolitiques de l’époque, il avait présenté les problèmes de déséquilibre dans la qualité de l’éducation et les types de formations à donner à la jeunesse, montré les préjudices désespérants de ces problèmes pour l’Afrique noire et proposé des pistes salvatrices. Plus d’un demi-siècle après, au vu des niveaux d’éducation et de développement des pays de cette partie du monde, l’on peut affirmer qu’il avait vraiment des raisons sérieuses de s’inquiéter pour notre avenir. Le même auteur avait, avec Mottin, quelques années plus tard, tiré la sonnette d’alarme pour la seconde fois dans L’Afrique étranglée(1980). Les auteurs se demandent si l’Afrique pouvait encore échapper aux désastres socioéducatifs et socioéconomiques qui leur semblaient alors inéluctables. Senghor, alors président de la République du Sénégal, déclara à Dumont : « Je dois reconnaitre que, au début, je vous ai beaucoup critiqué. Aujourd’hui, je suis obligé d’admettre que j’ai eu tort : c’est vous qui aviez raison. Nous aurions dû suivre vos conseils. » (Dumont & Mottin, 1980 : 15). Cet aveu d’un décideur politique africain de choix, qui arrive plusieurs décennies après, aurait certainement eu toute son opportunité s’il était dit à date; il est évident que le Sénégal, et à travers ce pays, l’Afrique noire toute entière auraient connu pendant tout le temps galvaudé, une avancée significative en matière d’éducation et de développement multisectoriel par rapport à leur niveau actuel.
Comme on peut le constater, les écueils sont nombreux. Nous ne nous attarderons pas davantage sur cette question d’autant plus que de nombreux travaux de recherche ont été menés et d’autres encore sont en cours, dans lesquels des pistes de solution sont esquissées (Pourtier, 2010; Hot et al., 2014). Pour nous, la reconnaissance de l’existence de ces problèmes constitue déjà un premier pas vers leur résolution dans la durée. Cette résolution ne pourrait se départir à la fois d’un ancrage et d’un ressourcement aux valeurs fondamentales, éthiques et matérielles de l’Afrique.
Absence de considération des avantages intrinsèques de l’Afrique
Par avantages intrinsèques, nous entendons les ressources naturelles, les valeurs en termes d’atouts humains, socioculturels et environnementaux dont dispose le continent africain pour impulser et soutenir son développement. Ceux-ci sont nombreux et propices au redéploiement des sciences mathématiques.
On observe que :
-
L’Afrique est dotée d’une bonne réserve de ressources humaines sur le continent comme dans sa diaspora. On note sur ce continent une forte croissance démographique[30].
-
Elle possède de grandes réserves naturelles du sol et du sous-sol non encore exploitées; de faibles fréquences de calamités naturelles : tremblements de terre, aléas climatiques (inondations, sécheresse…).
Tableau 8 : Nombre et effets des tremblements de terre entre 1901 et 2005 par continent – Source : EM-DAT : The OFDA/CRED International Disaster Database (www.em-dat.net), cité par Yin & Lalasz (2005).
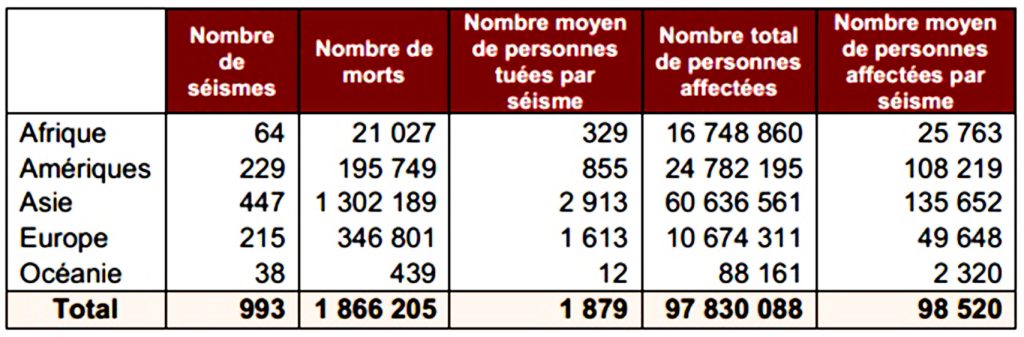
L’avant-dernière colonne à droite indique le nombre de personnes en état de besoin critique d’aide en nourriture, eau, abri, hygiène ou assistance médicale d’urgence. Ce tableau indique que l’Afrique occupe la deuxième position du classement des continents les moins secoués par les mouvements tectoniques. Enfin, des savoirs endogènes des peuples qui peuvent encore être codifiés et insérés dans les systèmes éducatifs[31] afin que les finalités éducatives fixées cadrent avec l’idéologie de la pensée africaine.
L’Afrique dispose entre autres d’une population assez jeune : dans un contexte de bonne gouvernance, cette jeunesse, si elle est bien encadrée par une éducation de bonne facture, disons mathématique, elle sera très imaginative, ingénieuse et ouverte aux questions de développement. Bref, une jeunesse résiliente capable de vivre et de travailler dans des conditions parfois difficiles (conditions de scolarisation, conditions de formations initiale ou continuée, résistance quotidienne à diverses formes de pression et autres stress).
Sur ce point, Pourtier trouve que :
Le continent le plus pauvre est en effet le continent le plus jeune : les moins de quinze ans y représentent près de 45 % de la population, ce pourcentage frôlant les 50 % au Niger et en Ouganda. Par comparaison, cette catégorie d’âge ne compte que pour 15 % de la population de l’Europe. (Pourtier, 2010 : 102)
Contrairement à Pourtier, pour qui la structure démographique des pays subsahariens constitue un handicap pour leur accès rapide à l’éducation, nous pensons que la jeunesse de leurs populations est un avantage. Il est vrai que l’investissement pour leur formation représente un coût important qui, heureusement, peut être supporté par les revenus des produits du sol et du sous-sol de ces pays.
Bref, l’Afrique est un continent en devenir qui aspire à l’émergence. Elle peut encore prétendre parler d’universalité scientifique, car des problématiques nouvelles y sont encore possibles et nombreuses en matière de recherche. Elle demeure un véritable chantier de réflexion et d’innovations technologiques, propice à la mise en œuvre de nouvelles pédagogies, à l’exemple d’une forme de pédagogie hybride que nous avons conçue et que nous nommons approche pédagogique par les capacités/compétences, la stratégie et l’inventivité (APCSI)[32].
Nécessité d’une action « thérapeutique » d’urgence
Dans la perspective d’une éducation et d’une formation compétitive et de qualité destinées aux Africain·e·s, tous les apports sont déterminants. Cette formation devra s’appuyer sur le développement de l’imagination, la rigueur et la précision depuis la base. Elle devra également bénéficier aux différentes catégories de personnes : les apprenant·e·s, les encadreur·se·s, les parent·e·s, les décideur·se·s, les responsables politiques et même les profanes. Il s’agit de toute personne qui s’intéresse à la discipline sans en être une spécialiste et qui n’est inscrite dans un établissement formel. Quant aux apprenant·e·s, ce sont des personnes inscrites dans un cadre de formation formel et qui sont assoiffées de connaître le pourquoi, le comment et la finalité des choses qui leur sont enseignées. Pour ce qui est des encadreur·se·s, cette catégorie englobe les enseignant·e·s, les tuteurs et les tutrices en matière de recherche qui doivent ajuster, avec le talent d’un artisan professionnel, la psychologie du développement cognitif chez les apprenant·e·s; ces personnes devront également pratiquer une didactique des mathématiques efficace (Vergnaud, 1982; Traoré & Barry, 2007). Par ailleurs, le rôle de ceux et celles qui soutiennent les apprenant·e·s dans le cadre familial, notamment les parents et les personnes généreuses, est primordial. Enfin, les politiques et les gestionnaires de l’éducation en général doivent envisager un changement positif efficient, dans le sens de l’amélioration des conditions socioéducative et économique des hommes et des femmes.
Sur le système éducatif, les programmes et la recherche en didactique des mathématiques
Les objectifs de l’enseignement de la médiatisation des mathématiques aujourd’hui ne se formulent plus seulement en termes de démystification et de vulgarisation de cette discipline auprès du public : ses résultats sont suffisamment riches et perceptibles à travers ses interactions. Mais, ils intègrent également la médiation : la médiation humaine. Malgré le fait que la médiatisation technologique semble prendre davantage de place dans les formations scolaire et universitaire, ainsi que dans le reste de la société, la médiation humaine reste importante, surtout quand il faut organiser et encadrer la profession enseignante, notamment la formation des enseignant·e·s de mathématiques. Un module sur la communication et la formation médiatisées, portant sur la double nature communicationnelle et formative (Peraya, 1999) des médiateurs et médiatrices dans cette discipline, mérite d’être inscrit dans les programmes de formation initiale (dans les écoles normales) et continuée (sur le terrain).
Il faut reconnaitre que la médiation humaine reste fondamentale dans les apprentissages, fussent-ils médiatisés. La flexibilité, la mobilité, l’ouverture et la nature contextualisable de la médiation humaine rendent celle-ci irremplaçable pour suivre l’apprenant·e jusqu’au cœur des processus d’apprentissage/expérimentation transformés par leur instrumentation. Aussi peut-on, avec Gettliffe-Grant, se poser les deux questions suivantes : « L’apprenant[·e] peut-il [/elle] apprendre seul[·e]? » (2004 : 4); « la médiatisation technologique peut–elle se substituer à la médiation sociale [humaine] qui rend possible le processus d’apprentissage [/expérimentation]? » (2004 : 5). En effet, dans le mot apprentissage, nous avons le concept « apprendre ». Et d’après Gettliffe-Grant (2004), Belisle reprend effectivement ce concept pour affirmer « qu’apprendre n’est pas seulement un transfert de contenus, mais une construction des connaissances mise en œuvre par un sujet social inséré dans un contexte. L’apprentissage de cette construction est facilité par une médiation sociale, une relation d’aide et de guidance […]. » (p. 4-5).
Nous pensons qu’en général, les concepts de médiation et de médiatisation sont complémentaires. Belisle note que :
médiation et médiatisation sont deux concepts qui ne se recoupent pas. Le propre des médias est de fournir des systèmes symboliques de modélisation du réel. Il est vrai qu’ils mobilisent plus les capacités perceptives et élargissent donc la base de l’intelligence pratique. Cependant, cet élargissement de l’expérience d’apprentissage ne supprime pas le rôle de l’enseignant qui doit aider l’apprenant à se situer dans de nouveaux systèmes de représentation. (Belisle, citée par Gettliffe-Grant, 2004 : 5)
Cette volonté de couplage, médiation et médiatisation à l’enseignement des mathématiques dans nos sociétés vise, grosso modo, la compréhension, le rapprochement et la (re)conciliation des mathématiques avec ce grand pan du public qui très souvent reste réfractaire à cette discipline.
Dans cette optique, il s’agit de mieux communiquer et diffuser les mathématiques à travers des programmes et méthodes d’enseignement-apprentissage-expérimentation de qualité; cela pour mieux partager leurs savoirs et projeter ensuite ces savoirs dans la société, selon des perspectives citoyennes et sociétales. Comme les phénomènes d’échec et de décrochage dans les filières mathématiques semblent s’enliser malgré les efforts déployés par la plupart des pays africains, nous pensons que les objectifs de l’enseignement de cette discipline dans ce continent méritent d’être renforcés : on n’enseigne plus simplement les mathématiques comme un savoir savant dont la certification est consignée dans un diplôme, mais il faut en même temps éduquer des apprenant·e·s, à la compréhension des finalités de l’enseignement de cette discipline et à la reconnaissance de ses impacts sur la condition humaine.
La compréhension est à la fois moyen et fin de communication humaine. Or, l’éducation à la compréhension est absente de nos enseignements […]. Étant donné l’importance de l’éducation à la compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme des mentalités. (Morin, 1999 : 3)
Pour ce faire, des travaux pédagogiques et didactiques adéquats devraient être orientés, d’une part, vers le développement de la culture mathématique par l’intermédiaire du renforcement de l’identité culturelle et des capacités mathématiques de chaque élève. Ce second concept renvoie à l’ensemble des opérations cognitives, des habiletés et des connaissances qui composent les tâches mathématiques (Mayer, cité par Soriano, 1998 : 27). D’autre part, ces travaux mèneront vers un service civil des mathématiques. Brousseau appelle « service civil » le fait qu’on inculque aux enfants :
beaucoup de connaissances dont nous savons que la plupart risquent de ne pas leur servir personnellement, mais qu’ils doivent apprendre parce que la société aura besoin de trouver, le moment venu, les médecins, les ingénieurs, les boulangers et les mathématiciens dont elle a besoin. (Brousseau, 2005 : 224)
Cependant, un rappel sous forme de mise en garde est fait à l’endroit des didacticien·ne·s : « vouloir imposer à tous les élèves les normes des forts en maths est une violence, acceptée par ignorance de la didactique. Et la violence est le dernier refuge de l’incompétence » (Desmaret,1997 : 34). Dans cet ordre d’idées, la médiation entre les humains et les mathématiques se révèle d’ordre instrumental, car l’outil mathématique n’est plus seulement un objet d’interactions, mais il est aussi médiateur de connaissances qui se sont cristallisées dans la mémoire de l’individu.
L’éducation à la compréhension, au questionnement et à la stratégie fait partie des aspects pédagogiques préalables qui, pour leur nouveauté, nous semblent essentiels dans un double point de vue. Ils permettent aux enseignant·e·s de mieux réfléchir sur la qualité et la portée des services qu’ils et elles rendent au quotidien dans le cadre de leurs missions régaliennes. Aux apprenant·e·s, elles contribuent aisément à la consolidation des rapports communicationnels et des liens affectifs enseignant·e·s–apprenant·e·s, et sous–tendent la pédagogie de transmission (par répétition ou par stratégie), d’acquisition, d’appropriation, d’évaluation et de manipulation des outils mathématiques utiles et adaptés aux contextes culturels africains.
Pour remplir avec « la qualité » espérée sa mission aussi exaltante qu’exigeante, il est indispensable et d’une importance capitale pour le « bon enseignant des mathématiques » de « tenir compte » à la fois de « la nature, l’essence et la finalité des mathématiques ». Cela suppose qu’il ait pris le temps et la peine préalablement d’y réfléchir sérieusement et de méditer sur ce que cela implique pour sa manière d’enseigner, de transmettre cette « vénérable et prestigieuse tradition de pensée » que représentent les mathématiques. (Adjamagbo, 2009 : 2, paragr. 4)
La réussite dans ce changement de paradigme nécessite des motivations fortes de la part des acteurs et actrices de la première ligne. Ces questions rentrent toutes dans ce qui est convenu aujourd’hui d’appeler la publicisation de la science, c’est–à–dire sa « mise en public » (Paillart, 2005).
De plus, les rapports didactiques entre enseignant·e·s et apprenant·e·s basés sur le concept « enseignement–apprentissage » préoccupent les neuroscientistes-mathématicien·ne·s. Sur le plan de l’évaluation qui reste un moment fort de la pédagogie, les résultats de leurs recherches prouvent qu’il y a des implications très remarquables des méthodes d’enseignement pratiquées par un enseignant ou une enseignante sur les qualités structurales (la forme et le fond) des épreuves proposées et par conséquent sur la façon dont il ou elle évalue ses élèves. D’après ces investigations, l’apprentissage par répétition et l’apprentissage par stratégie sont des méthodes différentes qui « peuvent déboucher sur la création de voies neurales différentes pour un même savoir mathématique. » (OCDE, 2007 : 109). Il est donc important pour les enseignant·e·s des pays africains de concevoir des évaluations : formative, sommative et certificative, aux finalités bien ciblées et en rapport avec leurs enseignements.
Puisque le processus par lequel le savoir est encodé influence le substrat neural, des évaluations binaires (exact/faux) ne permettent pas de tester l’apprentissage, puisqu’elles ne permettent pas de distinguer un fait appris par cœur d’un fait appris suite à l’emploi d’une stratégie. Pour s’assurer qu’un élément a été compris, il faut utiliser des méthodes d’évaluation plus fines. (OCDE, 2007 : 109)
Ainsi, la corrélation entre la performance des élèves et le type de questions et la façon de les formuler est clairement établie. Il est du ressort des enseignant·e·s d’infléchir le mode d’évaluation vers la construction et la consolidation des savoirs plus élaborés d’autant plus que le succès de ces apprenant·e·s est tributaire de la manière par laquelle on vérifie leur acquisition. La méthode évoquée par Stevenson & Stigler (1992) constitue une piste à considérer.
Cette méthode […] comprend des évaluations régulières qui mettent bien en évidence le processus d’apprentissage, et s’intéressent à l’élaboration des apprentissages plutôt qu’à l’identification de réponses exactes ou fausses. D’ailleurs, les erreurs sont mises à profit pour identifier les points faibles de l’apprentissage et améliorer la compréhension. (OCDE, 2007 : 109)
Plutôt que de chercher à vérifier les réponses correctes ou fausses, la démarche vise alors à déceler le travail de construction dans l’appropriation des connaissances. L’autre fait important, c’est la prise en compte des erreurs comme des éléments faisant partie intégrante des étapes de l’apprentissage. De telles évaluations sont donc susceptibles de « donner une représentation du savoir plus précise que celles qui aboutissent à des mesures binaires correct/faux. » (OCDE, 2007 : 109)
L’OCDE attire ici l’attention des communautés éducatives et conseille ceux et celles des enseignant·e·s qui utiliseraient des évaluations binaires et ou basées sur des questions à choix multiples à adopter des évaluations susceptibles de mettre en évidence les processus d’apprentissage et les potentialités individuelles des apprenant·e·s. Dans ce contexte, les réajustements nécessaires seront inéluctablement un réaménagement des conditions de travail des enseignant·e·s par les pouvoirs compétents.
En ce troisième millénaire, les ressources humaines en Afrique, notamment les didacticien·ne·s, les enseignant·e·s d’expérience, les formateurs et les formatrices chevronné·e·s de mathématiques ne doivent plus être à la remorque de leurs collègues, qui sous d’autres cieux – Asie, Amérique, Europe, par exemple – mènent, d’après Makrides (2012), des recherches didactiques approfondies sur des problématiques locales et/ou globales de développement. Dans cette optique, depuis les années 1960, certains pays africains ont à plusieurs reprises révisé leur système scolaire et leur politique d’éducation. Ces changements ont été souvent inspirés par la volonté des politiques qui ne privilégient pas toujours l’assentiment des praticien·ne·s : au Sénégal, par exemple, la loi d’orientation 91–22 du 16 février 1991 (Feyfant, 2007); et au Kamerun, la loi d’orientation n°98/004 du 14 avril 1998 et l’Arrêté n°263/14/MINESEC/IGE du 13 août 2014 portant définition des programmes d’étude des classes de 6e et 5e entre autres.
En nous appuyant sur la loi d’orientation de l’éducation au Kamerun, nous inscrivons notre action dans le cadre du mouvement qui vise à repenser le rôle des mathématiques dans la vie courante et dans le développement de l’Afrique contemporaine. En effet, cette loi prescrit entre autres que « l’enseignant est soumis à l’obligation d’enseignement, d’éducation, d’encadrement pédagogique, de promotion scientifique, d’évaluation et de rectitude morale. » (Chapitre III, article 39). Notre démarche trouve sa justification dans trois des missions déclinées dans cet article. Il s’agit de la promotion scientifique à travers un questionnement de l’enseignement des mathématiques, de leur place dans la société, ainsi qu’à travers des enquêtes sur le phénomène d’échec en mathématiques. Quant à l’évaluation, elle est présente à travers les données sur les pratiques de classe que nous analysons. Et pour ce qui est de la rectitude morale, elle découle de nos observations sur le contexte, les problèmes qui se posent en milieux d’apprentissage que nous avons la possibilité d’appréhender en tant qu’enseignant et acteur au sein du milieu de l’éducation de manière générale.
Au regard de la situation préoccupante que nous venons de décrire, nous interpellons ici les didacticien·ne·s, les enseignant·e·s pétri·e·s d’expérience, les formateurs et les formatrices chevronné·e·s à s’interroger sur les trois paramètres suivants : les motivations personnelles, les stratégies d’enseignement et le matériel didactique.
Premièrement, devons-nous demeurer dans la résignation et continuer à « jouer », c’est–à–dire à faire semblant d’agir sans véritablement faire bouger les choses? Un exemple parlant d’une absence de volonté chez le personnel enseignant nous est donné quand l’on observe des enseignant·e·s formé·e·s en quantité, mais peu soucieux et soucieuse de la qualité de leurs enseignements, et surtout peu enclin·e·s à la moindre réflexion sur leurs propres gestion et pratiques de classe. N’est–ce pas là une manière de caresser seulement les branches de l’arbre sans pour autant attaquer l’essentiel, c’est–à–dire le tronc, et par ricochet les racines, la base? Les enseignant·e·s devraient faire montre de beaucoup de volonté et d’abnégation au travail.
Deuxièmement, devons-nous continuer à procéder comme dans divers travaux antérieurs qui dans leur argumentaire traitent séparément, au lieu de les examiner dans leur ensemble comme un tout, les différentes causes potentielles qui font des mathématiques un véritable « cauchemar » en milieu scolaire et dans certaines filières universitaires? Nous pensons que la démarche doit être différente dans la mesure où les véritables mobiles du rejet des mathématiques se trouveraient dans l’environnement, les attitudes et les pratiques enseignantes. Par ailleurs, les changements décidés par les instances compétentes en matière d’éducation surviennent toujours de façon brutale, sans préparation, sans préalables. Doit–on changer de paradigme pédagogique sans recyclage préalable des facilitateurs et des facilitatrices? (Nkoumou, 2015). Auparavant, a-t-on évalué le dispositif en place? La réforme a-t-elle pris en compte les avis des différent·e·s acteurs et actrices de l’éducation? Une réponse négative à ces questions signifie qu’il y a des préalables irréfutables à tout changement pédagogique de grande envergure qui vise à arrimer les connaissances et la profession au temps et aux besoins. De nombreux exemples, dans le contexte camerounais, montrent que l’omission de l’avis de certains a donné lieu à des débats houleux et à la manifestation d’un mécontentement non négligeable. Le cas du manuel de science de la vie et de la terre pour la classe de 5e sur l’éducation à la sexualité[33] est un exemple qui témoigne de l’importance d’une implication de l’avis des parents d’élèves dans les choix des contenus d’enseignement et leurs rapports aux valeurs culturelles locales. De même, la résistance observée chez les enseignant·e·s vis-à-vis de la réforme de l’APC–ESV trouve son origine dans l’exclusion des praticien·ne·s à la réflexion. Cette situation a même pris l’allure d’un passage en force dénoncé par Evouna (2019).
S’agissant des mathématiques, quels mobiles louables pour l’éducation ont-ils poussés à suspendre la production de l’observatoire des mathématiques dans le système éducatif camerounais? Par quelle alchimie, le MINESEC pourrait-il désormais évaluer en toute objectivité l’enseignement de cette discipline dans les lycées et collèges? Nous pensons que l’exploitation des documents tels que les rapports des animateurs pédagogiques, les rapports des conseils de classe, les bulletins d’inspections-conseils et d’inspections chiffrées, ne suffirait pas.
Pourtant, pour résoudre ces problèmes, une démarche de consultation, puis de renforcement des capacités des enseignant·e·s à la base offre une garantie certaine.
Une garantie d’un enseignement qui respecte l’évolution des savoirs et de la profession. Afin de faciliter l’adhésion des enseignants dans un processus de changement, il importe de ne pas déqualifier l’expertise en place, mais plutôt de réaffirmer les aspects positifs de ce changement. (CONFEMEN, 2008 : 75)
Sur le même plan, on doit pouvoir se demander s’il faut continuer à encadrer en formation initiale ou continue, aussi bien en présentiel qu’à distance, des milliers d’enseignant·e·s qui sombrent très vite dans la démotivation (Stewart, 2006), et même le décrochage pour certain·e·s qui vont migrer vers d’autres administrations. Pour Sokhna et Sarr, la solution se trouve dans la formation qui nécessite d’être reconsidérée et adaptée aux nouveaux contextes.
Face aux besoins importants de scientifiques et à l’urgence d’un recrutement massif et régulier d’enseignants de mathématiques et de sciences, les systèmes éducatifs africains sont obligés, pour plus d’efficacité, de changer de stratégies de formation. Des stratégies de formation à distance basées sur un dispositif d’autoformation et de co-formation qui part des besoins exprimés par les enseignants à partir de leurs pratiques de classe sont particulièrement innovantes dans ce domaine. (2009 : 919)
Cette approche de formation à distance est orientée essentiellement vers les enseignant·e·s déjà en activité sur le terrain. Elle est constituée de cours de perfectionnement et/ou d’enrichissement de pratiques pédagogiques. Or, le contexte de travail des enseignant·e·s dans les pays africains au sud du Sahara est peu favorable (CONFEMEN, 2008) à la mise en place de dispositifs d’autoformation et/ou de co-formation : salaire peu décent, environnement démotivant, cadres social et familial peu confortables, manque d’outils informatiques (ordinateur personnel de qualité, téléphone portable de bonne capacité de stockage), absence de réseaux internet stables, absence d’un véritable soutien des pouvoirs publics, etc. Dans les centres multimédias et autres salles informatiques, quand ils existent dans les établissements scolaires, les machines sont désuètes et la connexion est incertaine. Sokhna semble minimiser les réalités contextuelles relatives à la précarité des conditions de formation des enseignant·e·s et qui se reproduit visiblement sur leurs conditions de travail.
Nous pensons que la formation des futur·e·s enseignant·e·s devrait être suffisamment complète en phase initiale, pendant que ces personnes sont encore dans les écoles normales publiques ou privées, avant leur recrutement ou leur contractualisation et leur déploiement sur le terrain. La formation à distance proposée par Sokhna ne devant venir qu’en renforcement des acquis pédagogiques reçus pendant la formation initiale. Sa proposition nous semble mieux accessible quand l’enseignant·e·dispose déjà des capacités financières suffisantes pour assurer son autoprise en charge en matière de renforcement des capacités. S’agissant de la formation des enseignants·e·s, deux questions méritent de retenir notre attention : à quel moment et pour quelle finalité tel module au lieu de tel autre module devrait-il être introduit et/ou traité pendant le cycle de formation de l’enseignant·e·de mathématiques? Jusqu’à quand les programmes de formation dans les écoles normales supérieures deviendront-ils plus ouverts à la professionnalisation qu’à l’académie, apanage des facultés universitaires?
Nous sommes d’avis que des sujets sur la contextualisation des enseignements de mathématiques, les atouts et les limites de l’approche pédagogique en vigueur, la recherche des liens interdisciplinaires scolaires, la didactique de l’enseignement des mathématiques, les stratégies de renforcement des activités et les chantiers d’innovations pédagogiques entre autres devraient être traités comme thèmes de recherche dans les écoles normales (formation initiale), avant d’être revisités pendant les séminaires pédagogiques (encadrement de proximité) et/ou lors des sessions de formation à distance. Il est souhaitable que les pouvoirs publics prennent leur responsabilité et trouvent une réponse recevable à cette inadéquation entre les sujets traités par les normalien·ne·s pendant leur formation, les approches et les contenus pédagogiques à développer sur le terrain, dès le lendemain de leur prise de service. Cette situation paradoxale semble d’ailleurs avoir un effet négatif sur la qualité et la gestion du livre scolaire.
En effet, le choix de la vente directe du livre n’est pas approprié pour des pays pauvres et essentiellement inégalitaires. Si cette forme de transaction permet de réduire le coût grâce notamment à la suppression des intermédiaires, il faut reconnaitre qu’il ne convient guère à un secteur aussi délicat que l’éducation. On peut se demander par exemple combien de parents d’élèves ont les moyens d’acquérir les livres et les manuels scolaires. Doit-on sacrifier la disponibilité du livre scolaire au profit des avantages de quelques esprits cupides? La pénurie, les retards et la quasi-absence des livres dans les localités éloignées des centres urbains ne nous invitent-ils pas à opter pour une politique juste et équitable dans l’accès et la disponibilité des livres? L’expérience sénégalaise nous donne une piste dont l’efficacité est reconnue par des spécialistes. Depuis 2013, le Sénégal, dans le cadre d’une collaboration avec le Canada, a mis en place un système d’approvisionnement en manuels scolaires gratuit et performant pour ce qui est des établissements scolaires publics. En 2014 et 2015, « plus de 3,3 millions de manuels scolaires ont été remis à 1,3 million d’élèves. L’élève peut désormais apporter son manuel à la maison, poursuivre ses activités scolaires et échanger quotidiennement avec ses parents sur ses apprentissages (Gouvernement du Canada, 2017, paragr. 5). Dans le cas du Kamerun, l’Association des parents d’élèves et enseignant·e·s (APEE), une association libre, peut être un partenaire efficace[34] dans la mise en place d’un dispositif similaire; ceci dans la mesure où chaque élève a l’obligation de verser une somme d’argent appelée « frais d’APEE » [35].
Ces questions nous permettent ainsi de dresser un tableau des différents problèmes relatifs aux trois aspects fondamentaux de l’éducation que sont la politique éducative, les contenus et les méthodes d’enseignement. Dans le cas spécifique des mathématiques, ces questions trouvent des solutions dans une activité urgente de renouvellement et d’innovation multidimensionnels. Perrin, menant une réflexion sur le thème « Pourquoi faut-il enseigner les mathématiques aujourd’hui? », conclut sa présentation en ces termes :
J’espère vous avoir un peu rassurés : oui, il est encore nécessaire en ce nouveau millénaire, d’enseigner les mathématiques. Attention toutefois, nous devons écouter ce que nous dit le monde extérieur et essayer de comprendre comment notre discipline a pu, en quelques années, passer d’un statut de discipline reine à celui de matière dont la survie même est contestée. (Perrin, 2004 : 20)
On peut retenir de ce propos, deux idées forces. Premièrement, il affirme la nécessité de continuer à enseigner les mathématiques aujourd’hui. Ainsi, les enseignant·e·s de mathématiques, face aux difficultés de divers ordres, ne doivent pas se résigner. Il leur revient alors de rechercher, de trouver, de concevoir et de mettre en place des méthodes et des dispositifs plus attractifs et plus utiles. Cependant, cette tâche qui requiert inventivité et ingéniosité ne saurait se réaliser sans un préalable : un regard critique et un examen épistémologique impératifs. C’est ce qui explique la mise en garde de Perrin (« Attention toutefois ») sur deux faits importants : la prise en compte des points de vue des personnes extérieures à la discipline (« monde extérieur ») et une recherche des causes de l’affaiblissement de la position des mathématiques parmi les autres sciences. De cette remise en question découleront des pistes de solutions. L’une de ces pistes est la recherche de motivations fortes qui redonneraient aux pouvoirs publics et gestionnaires des systèmes éducatifs des pays africains[36] une nouvelle détermination dans le but, d’une part, de renforcer leurs capacités afin de relancer la dynamique de l’éducation mathématique dans leurs pays respectifs. Ceci se fera à travers une véritable « sociothérapie » en milieu scolaire et universitaire devant aboutir à l’apprentissage et l’expérimentation au quotidien des mathématiques par les jeunes[37]. D’autre part, il est question de s’arrimer sans trop de difficultés à ce que Touoyem (2016) appelle « l’ère de la science ouverte ». Ce concept est défini de la manière suivante :
La « science ouverte » renvoie, d’une part, à de nouvelles manières de pratiquer la recherche scientifique [et l’enseignement] dans tous les domaines : accès libre aux publications scientifiques (grâce aux archives ouvertes), revues en libre accès, partage des données, science en ligne, partage des bibliographies, recherche-action participative, ouverture de la recherche et des universités vers la société civile, démocratie scientifique, etc. D’autre part, elle implique une réflexion critique sur l’ordre normatif dominant de la science contemporaine et le désir de rétablir un certain équilibre en créant plus de « justice cognitive » […], plus de respect et de visibilité pour la science faite dans les pays du Sud. (Piron, citée par Touoyem, 2016 : 340)
La posture de Piron que rappelle ici Touoyem repose sur trois socles auxquels nous adhérons. Premièrement, l’accès aux savoirs scientifiques est fondamental, surtout pour les sociétés africaines qui possèdent très peu de facilités dans ce domaine. Nous avons l’impression que dans nos écoles et universités, la formation est presque toujours à la traine de l’évolution des progrès de la science et de la technologie. Cette perception est une conséquence évidente de l’inadéquation notée entre les formations dans ces institutions et les emplois sur les marchés locaux. Cette situation résulte notamment du fait que les enseignant·e·s ne sont ni au fait de la dynamique scientifique ni dans les dispositions pouvant leur permettre de mettre à jour leurs enseignements. Un accès libre à la documentation scientifique la plus récente et à travers des cadres d’échanges avec les pays d’autres continents est une solution à la fois pratique et peu coûteuse. Deuxièmement, la relation entre la recherche dans nos écoles et universités d’une part et la société d’autre part devrait être revue. Ici, nous devons nous poser clairement la question de la contribution de l’enseignement des mathématiques et de la formation au développement sociétal. Troisièmement, la nécessité d’un équilibre et d’une équité en termes de représentativité et de visibilité dans le domaine de la recherche scientifique en général doit être franchement adressée. Il s’agit de se poser la question de la « justice cognitive »[38] en science, en valorisant les travaux des chercheur·se·s d’Afrique, « c’est-à-dire rendre plus visibles et accessibles sur le web les savoirs des pays des Suds. » (Piron, Regulus, & Dibounje Madiba, 2016 : xx). Il est vrai que depuis les indépendances africaines, les débats sur l’éducation, les systèmes d’enseignement, le choix des matières ou des langues d’enseignement sont le reflet d’un tiraillement entre revendication nationale et héritage colonial, et soulèvent de ce fait des questions éminemment politiques (Pourtier, 2010).
Rappelons que ces préoccupations n’épargnent en général aucun continent. En effet, nous constatons avec Touoyem que même « les savants et les philosophes qui s’interrogent aujourd’hui sur la science en Occident montrent que la manière dont elle se développe ne cadre plus avec les attentes de l’Occident lui-même. » (2016 : 340). Ainsi, selon l’auteur, la solution que représente la science ouverte est encore très peu répandue dans la plupart des pays africains. De façon concrète, si l’on pouvait envisager et mettre en place des plateformes de partage et de libre accès des informations sur de nouvelles méthodes et pratiques de classe, sur les expériences mutualisées d’enseignement des mathématiques de divers horizons, on obtiendrait à coup sûr de meilleurs résultats, car plus les enseignant·e·s sont informé·e·s, plus ces enseignant·e·s ont des outils didactiques appropriés, plus ils et elles offriront le meilleur d’eux et le meilleur d’elles avec à terme de meilleurs résultats.
Le conseil pédagogique, l’un de ces cadres de réflexion est d’un apport efficace dans l’amélioration du rendement scolaire. Pour remédier à la situation d’échec et de décrochage scolaires, les pouvoirs publics et les gestionnaires du système éducatif pourraient, dans le cadre de la recherche des stratégies optimales, soutenir la recherche sur des questions comme : quels enseignements des mathématiques pour quels profils de sortie? Quelles sont les sources des préjugés et des représentations négatives vis-à-vis des mathématiques? Quelles peuvent en être les solutions? Comment tenir compte des résultats des recherches en neurosciences[39] dans la conception des programmes, l’organisation de la scolarité et l’orientation scolaire? Quels cadres dans les pouvoirs publics, l’administration scolaire et universitaire peuvent participer à faire reculer ces images défavorables pour les mathématiques. Songeons, un tant soit peu, à la contribution du service de l’orientation scolaire et universitaire. N’est-ce pas le cadre idoine où se règlent les difficultés psychosociales que rencontrent les apprenant·e·s? Ne pourrait-on pas munir les conseiller·e·s d’orientation d’outils et de moyens appropriés pour inverser une vision et une attitude défaitistes, démotivées et résignées en une attitude optimiste, engagée? Les conseillers et conseillères en orientation scolaire et professionnelle ne devraient-ils ou elles pas aller plus loin que le passage des tests psychopédagogiques? On pourrait même reconsidérer la formation des conseillers et conseillères en orientation en les dotant de savoirs et de savoir-faire pour prodiguer des conseils spécialisés, aux apprenant·e·s, par discipline ou par groupe de disciplines.
Les propositions évoquées ci-dessus pourraient davantage convaincre la jeunesse à retourner à l’école pour ceux et celles qui ont abandonné leurs études, à s’intéresser aux mathématiques pour ceux et celles qui nourrissent une désaffection à l’égard de cette discipline, à mieux prendre conscience du sérieux qu’elle devrait consacrer à la construction de son avenir, à s’intéresser et s’appliquer davantage dans la pratique et l’expérimentation quotidienne des mathématiques dans toutes ses actions. Par conséquent, nous pouvons reprendre à notre compte, mutatis mutandis, l’assertion de Jaspers à propos du caractère indispensable de la philosophie : « L’homme ne peut se passer de la [mathématique]. Aussi est-elle présente partout et toujours, répandue dans le public… » (1981 [1950] : 10). On la retrouve dans les pratiques marchandes traditionnelles, dans les formules de gestion courante de la fortune et aires culturales, dans les pratiques opératoires conventionnelles. Russell, quant à lui, met en garde toute personne qui aspire à être philosophe : « celui qui veut devenir philosophe a tout avantage à acquérir une vaste connaissance des mathématiques » (Russell, 2005 : 6); une acquisition de connaissances basée sur une approche historique afin d’être au fait des grandes lignes des théories mathématiques, pour se familiariser avec le raisonnement hypothético-déductif et pour minimiser les erreurs de jugement de tout genre.
Autrement dit, les mathématiques ne sont pas l’apanage d’une catégorie de personnes. Elles constituent toute une culture, une façon de penser opératoire et opérationnelle susceptible d’être reçue par tout le monde à travers les générations. Les mathématiques élémentaires, grâce à leur démarche (réfléchie, logique, systématique…) et quand elles sont débarrassées de leurs signes, symboles et autres figures géométriques, sont donc une activité populaire. Celles-ci n’exigent aucune restriction fondamentale pour ceux et celles qui désirent l’exercer, la pratiquer. Il est aisé de constater que dans l’imagerie populaire le simple fait d’évoquer le mot « mathématique » fait tout de suite penser, dans la plupart des cas, aux signes, aux symboles et aux figures abstrait·e·s; reléguant de ce fait la démarche au second plan. L’idée, ici, c’est d’inverser cet ordre en priorisant la méthode mathématique dont les vertus en matière de rigueur et de cohérence sont reconnues. C’est d’ailleurs là le tremplin pour toute phase d’apprentissage. Des enfants aux adultes, aucun n’échappe aux mathématiques dans la gestion quotidienne de sa vie.
En réalité, la pratique des mathématiques peut être consciente ou inconsciente. C’est le cas de ce jeune qui répare aisément un téléphone portable high-tech sans avoir achevé avec succès ses études de mathématiques et d’informatique du cycle primaire. À contrario, on a également des cas d’intellectuel·le·s et d’ingénieur·e·s de haut niveau qui peuvent raisonner et discourir sur la constitution et le fonctionnement de cet appareil sans en avoir jamais vu l’intérieur. On distingue ainsi, la connaissance de l’appareil et la connaissance sur l’appareil. C’est ce qu’explique le philosophe du langage Auroux quand il prend l’exemple de l’intégrateur. Il fait une distinction entre la connaissance de ce qui se passe dans la machine appelée intégrateur et le discours sur cet intégrateur. Tout en reconnaissant que la connaissance de l’intégrateur est en relation avec le discours sur l’intégrateur, il précise que les deux connaissances n’ont de relation que sur la base de postulat ou d’hypothèse. Ainsi, on peut être en mesure de discourir et de raisonner sur l’intégrateur sans jamais avoir vu l’appareil lui-même : « c’est le cas d’un mathématicien qui n’a jamais vu d’intégrateur! Il pourra en dire quelque chose du genre : toute machine intégratrice devra considérer deux variables, les variations de l’une dépendront de la valeur instantanée de l’autre. » (Auroux, 1992 : 44).
Les mathématiques occupent une place de choix parmi les disciplines scientifiques en ce qu’elles offrent un modèle de recherche empirique ou inférentiel de la vérité scientifique exempte de toute transgression ou contradiction. Avec l’évolution de la recherche, on peut, en tout lieu et en toute circonstance, se demander aujourd’hui où on n’utilise pas les mathématiques? Dans quels secteurs d’activité n’utilise-t-on pas les mathématiques? Cette omniprésence des mathématiques dans la vie des hommes et des femmes contraste avec l’attitude de rejet qui s’observe chez ces mêmes personnes. Un tel paradoxe ne peut s’expliquer que par l’ignorance et les considérations stéréotypées dont les origines se trouvent dans des malentendus qui se sont généralisés au fil du temps. La démarche du pédagogue consisterait ainsi à agir de sorte à modifier ces idées « anti-mathématiques » pour les transformer en des idées favorables à cette discipline. Nous sommes là dans le droit fil de la stratégie de démystification des mathématiques : amener des personnes à reconsidérer leur désamour pour les mathématiques en leur apportant la preuve qu’ils pratiquent les mathématiques. Il est question de trouver les moyens d’agir positivement sur ce que pensent les gens à propos des mathématiques. Il est impératif de faire comprendre à l’opinion que les constructions mathématiques qu’elle pense être coupées de la réalité ont tout à voir avec les préoccupations de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui a faim, qui n’a pas de logement, qui a des problèmes de santé… De manière pratique, cette personne a besoin de réfléchir sur son environnement (géométrie, algèbre), d’offrir ses services (lois de composition, morphismes de structures), obtenir de l’argent et savoir le gérer (théorie keynésienne sur la propension marginale à consommer). Comme on le voit, en écartant tout le travail d’abstraction et en mettant en avant la démarche, on peut facilement faire ressortir la relation entre mathématiques et réalité.
Par ailleurs, les scientifiques en général doivent également se remettre en question et agir prioritairement sur les besoins réels en vue d’améliorer la vie quotidienne des humains. Nous faisons donc un plaidoyer pour des mathématiques au service du développement, des mathématiques mieux contextualisées et plus ancrées dans les cultures humaines. Dans ce sens, Sladek fait une observation assez bouleversante et appelle les scientifiques à plus d’humanisme.
Le problème de la science contemporaine, c’est qu’elle fournit des réponses à toutes les mauvaises questions. Personne ne demande si le laser est oui ou non un faisceau d’énergie cohérente opérant dans les limites du spectre lumineux […]. Personne ne veut savoir si E égale vraiment mC². Il est grand temps que les scientifiques sortent de leur tour d’ivoire, cessent de jouer avec les microprocesseurs ou l’analyse transactionnelle et s’attaquent à quelques-uns des vrais mystères de notre époque. (Sladek, cité par De Pracontal, 1986, leçon 3)
De Pracontal, dans sa posture de journaliste scientifique, s’attaque à deux principaux problèmes que l’on rencontre dans le monde scientifique; le premier étant sa relation avec les préoccupations réelles des citoyen·ne·s. Les résultats des travaux scientifiques sur l’armement, le dopage, le clonage, le problème de Fermat, le problème des corps, etc. constituent-ils les priorités parmi les problèmes humains? Le second problème est cette espèce de barrière qui s’érige entre le scientifique et la société (« tour d’ivoire ») et qui fait penser que le scientifique est un être à part et que son discours, voire ses formules (par exemple E = mC²) ne sont pas sujettes à discussion. Il déplore ainsi le fait que les savants pensent avoir mieux à faire que de s’occuper de nos « petits » problèmes journaliers (logement, santé, alimentation, chômage, drogue, insécurité, terrorisme…). Il convient de rappeler que De Pracontal, titulaire d’une maîtrise de mathématiques et d’un doctorat en sciences de l’information sur la vulgarisation scientifique, n’est pas un journaliste ordinaire. Il s’intéresse surtout à notre manière de traiter l’information pour certain·e·s et de l’accueillir pour d’autres : « Disposons-nous d’un esprit critique face à la masse d’information véhiculée par les médias? Ou sommes-nous à la merci de la société d’information? ». Étant donné que pour les médias et le grand public, l’irrationnel est souvent plus sensationnel que le rationnel, De Pracontal « va tenter de nous faire mieux distinguer le vrai du faux dans cette culture surmédiatisée, régie par ‟la dictature du marché et de l’audimat”. Car il faut l’avouer, pour les médias, il est beaucoup plus intéressant de présenter l’irrationnel et toutes les merveilles qu’il en découle plutôt que la froide rigueur scientifique… » (Utilisateur supprimé, 2004, paragr. 6)[40].
Pour ce qui concerne les mathématiques, l’insignifiance invraisemblable du degré de corrélation entre les « grands » résultats obtenus en laboratoire et leurs impacts observables sur les « petits » problèmes quotidiens de l’humain sème un doute au sein du grand public et le ramène à une résultante inéluctable : le refus de la science mathématique. Face à cette abondance d’informations et de désinformations sur l’importance des mathématiques pour la société, il convient de faire preuve d’un peu de discernement et surtout de beaucoup de bonne foi.
Dans le cas de l’Afrique, ce décalage entre le monde de la science (écoles, universités, instituts) et la société se trouve exacerbé par des facteurs d’un autre ordre : les croyances, les mythes et les attitudes physico-culturelles.
Sur les facteurs socioculturels : y a-t-il une disposition d’esprit favorable aux mathématiques?
L’histoire ainsi que les recherches démontrent que la différence entre les pays « pauvres » (d’Afrique en particulier) et les pays « riches » (d’Europe par exemple) n’est liée ni à une prédisposition défavorable quelconque ni à la race, encore moins à la couleur de la peau des peuples. Les travaux de Bessone (2013a; 2013b) sur le concept de race montrent que cette notion n’a aucun fondement biologique, mais elle est une construction sociale. De même, Gourou relève que les tests psychologiques utilisés pour montrer les différences d’intelligence « aboutissent toujours, quand les différences sont constatées entre les groupes, à révéler qu’elles sont liées à des conditions sociales. » (1959 : 143). En effet, des citoyen·ne·s d’Afrique considéré·e·s comme paresseux·es· dans leurs pays d’origine deviennent, lorsqu’ils et elles s’installent en toute légalité et dans des conditions favorables (en Afrique ou ailleurs), une puissance productive. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les classements réguliers des jeunes entrepreneur·e·s africain·e·s. Dans le classement Forbes Magazine[41] des 30 jeunes africain·e·s les plus prometteur·e·s en 2018, on retrouve des Nigérians ayant créé des entreprises dans le domaine du numérique et faisant un chiffre d’affaires annuel de plus de trois millions de dollars, des Sud-africains ayant mis en place des entreprises opérant dans l’énergie solaire ou encore ce Nigérian de 24 ans qui est le plus grand vendeur de voitures dans son pays, etc.
La problématique de l’échec et du décrochage en mathématiques au primaire, au secondaire comme au supérieur suscite toujours, et dans sa complexité, un intérêt sans cesse croissant auprès des scientifiques de l’éducation. La qualité et la quantité des apprentissages dans cette discipline, et partant, des méthodes d’enseignement restent au centre des investigations. Au primaire et au secondaire, l’interdisciplinarité scolaire est une approche prometteuse. Au supérieur, les neuroscientistes affirment que des solutions idoines contre ces fléaux viendraient d’une approche transdisciplinaire qui permettrait de mieux comprendre les apprentissages. La neuroscience des mathématiques est une discipline hybride née d’une posture scientifique et intellectuelle, la transdisciplinarité, qui renvoie à l’interdisciplinarité scientifique, de Lenoir & Sauvé (1998).
Ce concept va au-delà du cloisonnement entre les mathématiques et les neurosciences (la biologie, la génétique, neurologie, médecine…) pour obtenir leur fusion totale. Pour l’OCDE, la transdisciplinarité est ce
concept par lequel des disciplines complètement différentes, fusionnant l’une avec l’autre, donnent naissance à une discipline nouvelle dotée de sa propre structure conceptuelle, qui permet de faire reculer les frontières des sciences et des disciplines ayant présidé à sa formation. (2007 : 275).
À propos des neurosciences, il faut reconnaitre que :
La neuroscience des mathématiques n’en est qu’à ses balbutiements, mais le domaine a beaucoup progressé ces dix dernières années. Les scientifiques ont commencé à mettre au jour des influences biologiques pertinentes – comme l’association entre nombres et espace – et leurs travaux peuvent être nourris par les progrès rapides de la génétique. De plus, les chercheurs commencent seulement à étudier les effets que l’apprentissage des mathématiques a sur le cerveau. Ce sujet doit être étudié d’un point de vue dynamique et développemental, afin que les multiples voies possibles soient définies. (OCDE, 2007 : 111)
Malgré les efforts en matière infrastructurelle et en ressources humaines réalisés par des États africains dans le secteur de l’enseignement aussi bien au niveau public que privé, comment expliquer que le phénomène de l’échec en mathématiques reste toujours perceptible dans certaines structures éducatives pourtant mieux organisées? Les neuroscientistes-mathématicien·ne·s expliquent qu’il existerait chez certains humains un facteur purement biologique qui causerait des entraves à l’apprentissage mathématique, « la dyscalculie ».
Certains enfants ont des difficultés en mathématiques alors que leur formation est suffisante : cela peut être dû à une dyscalculie, l’équivalent mathématique de la dyslexie[42]. La dyscalculie est un trouble de la perception des nombres, de la compréhension des quantités numériques et de leurs rapports. (Landerl, Bevan et Butterworth, 2004, cités par OCDE, 2007 : 110)
Sans être en contradiction avec notre position selon laquelle les mathématiques se développent mieux à travers des apprentissages contextualisés dans un environnement nourri par une mentalité scientifique, ces résultats viennent renforcer l’idée des mathématiques comme création humaine, fruit d’une éducation culturelle millénaire : « la découverte de caractéristiques neurales atypiques associées à certains troubles mathématiques précis renforce l’idée que les mathématiques n’émergent pas uniquement d’un processus culturel. » (OCDE, 2007 : 110-111). Dès lors, le champ des préalables exigibles aux pratiquant·e·s et praticien·ne·s de cette discipline se voit ainsi augmenté : en plus de disposer et d’entretenir un état d’esprit de nature scientifique ouvert et fécond, il faut prédisposer d’un minimum de « bonne » structuration cérébrale spécifique : « certaines structures cérébrales, qui assurent les fondements conceptuels de l’apprentissage, doivent de plus être intactes et fonctionnelles. » (OCDE, 2007 : 111). Quand cette prédisposition biologique n’est pas naturelle comme chez les enfants précoces ou à haut potentiel en mathématiques (Camos, 2004), elle peut être acquise, pour les autres types d’enfant, par l’adoption d’une hygiène de vie assez spéciale dans un environnement de travail tout aussi spécial couplé à une bonne alimentation[43]. Cette prédisposition allierait à la fois bien-être physique et intellectuel, aspects émotionnels et cognitifs, esprit analytique et capacités créatrices.
La neuroscience montre que la façon dont on nourrit et traite le cerveau joue un rôle crucial dans les processus d’apprentissage, et commence à déterminer quels sont les environnements les plus favorables à l’apprentissage. La plupart des façons d’améliorer le fonctionnement cérébral dépendent de facteurs simples et quotidiens – qualité de l’environnement social et des rapports humains, alimentation, exercice physique et sommeil – qui semblent tellement évidents qu’on a tendance à négliger leur importance. En prêtant attention à l’état du cerveau et du corps, il est possible de mettre à profit la plasticité cérébrale et de faciliter l’apprentissage. Il faut adopter une approche globale, qui tienne compte des liens étroits entre bien-être physique et intellectuel et ne néglige pas l’interaction entre aspects émotionnels et cognitifs. (OCDE, 2007 : 14)
Il est donc important de reconnaitre qu’en dehors des espèces humaines rares comme les « génies », l’organisation socioculturelle et l’environnement ont un impact significatif sur la construction des capacités mathématiques des apprenant·e·s. Nous pensons que ces dernières ont, de ce fait, des fondements biologiques (et non raciaux !), psychologiques, analytiques et neuroscientifiques. Ici encore, l’enseignant·e peut avoir de l’influence dans cette construction des capacités des apprenant·e·s.
Le récit suivant est un témoignage personnel sur le contexte assez équivoque de l’éducation mathématique en Afrique et la contribution attendue des enseignant·e·s au réveil et à la construction de potentiel mathématique des apprenant·e·s. Cette anecdote est mon histoire.
Pendant tout mon cycle secondaire au lycée mixte de Yokadouma (Est-Kamerun), j’ai toujours été, malgré mon caractère un peu timide, un bon élève sur le double plan de la discipline et du travail. Cependant, en juin 1987 j’ai raté mon Baccalauréat C. Et pour cause : je n’ai pas obtenu une bonne performance en mathématiques. D’ailleurs, je n’ai pas eu de notes au-dessus de la moyenne pendant toute l’année scolaire. C’est ainsi que j’ai repris la terminale l’année scolaire suivante. Heureusement, l’administration nous affecte un nouvel enseignant de mathématiques, Monsieur Tankeu. C’est un jeune enseignant très engagé, un peu effacé, mais un travailleur patenté et rigoureux. En une année scolaire, Monsieur Tankeu, grâce à son approche pédagogique avant-gardiste, assez originale et qui se démarquait visiblement de l’approche par les contenus ou par transmission en vigueur à cette époque, m’a aidé à vaincre mes peurs et à sortir de ma timidité. Il appliquait avec efficacité l’approche par objectifs (APO). Nous travaillions intensément les cours et les exercices d’application en présentiel. Chaque élève avait l’obligation de passer au tableau pour traiter (avec succès ou non) une question dans un exercice ou un exercice entier. Sa gestion de classe créait l’esprit de défi entre les élèves. Il utilisait ces expressions comme un refrain pendant les séances de cours ou d’exercices : « Laissez de côté le superflu! », « Attaquez le problème! », « Qu’est-ce qu’on connait? », « Quelles sont les hypothèses du problème? », « Qu’est-ce que tu cherches? », « À quoi ça sert? », etc. Il était si rigoureux qu’il rendait souvent son cours ennuyeux, puisqu’il accordait très peu ou presque pas de temps pour les blagues.
Chaque fin de chapitre était marquée par des exercices ou une recherche à faire à domicile et à remettre une ou deux semaines après, selon leurs degrés de difficultés. La plupart de ces exercices étaient des exercices d’approfondissement tirés des livres de Mathématiques – Terminale C (tomes 1 et 2) des collections Monge et/ou Queysanne-Revuz. Ses évaluations étaient toujours structurées en trois parties : une première partie consacrée aux questions de cours; une deuxième partie portant sur des exercices d’algèbre, d’analyse et/ou de géométrie suivant le niveau progression dans le programme annuel; et une troisième partie constituée d’un problème. C’est ainsi que ma note en mathématiques est passée, d’une année à l’autre, de 05,5/20 à 12,5/20 avec le nouvel enseignant. En juin 1988, je réussis mon Bac avec la mention « Assez bien » et une moyenne (note de l’écrit et note de l’oral) de 14/20 en mathématiques. Je crois pertinemment que j’aurais eu une mention plus élevée si j’avais suivi les cours de cet enseignant deux ou trois années plus tôt.
Pendant l’année scolaire, mon environnement sociofamilial n’avait pas connu de changements importants. Je n’ai pas eu de répétiteur. Les seules nouveautés survenues dans mon environnement social étaient mon nouvel enseignant, avec sa méthode d’enseignement et d’évaluation, la discipline en termes de rigueur adoptée dans mon travail à l’école comme à la maison; et il y aussi la gestion stratégique de mes week-ends ponctués par les séances de football que je pratiquais régulièrement; c’était d’ailleurs mon passe-temps préféré. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Trois mois après, nous sommes au mois d’octobre 1988, période des inscriptions à l’Université de Yaoundé 1, je rencontre Monsieur Tankeu, mon enseignant de maths, en séjour dans la cité capitale. Pendant nos échanges, il me demande la filière que j’ai choisie. Je lui réponds que j’aimerais faire les sciences économiques ou les sciences physiques, mais avec une préférence pour le second choix.
– Non Christophe! répliqua-t-il. Compte tenu de tes performances en mathématiques, tu gagnerais à t’inscrire en mathématiques. Je sors alors ma fiche d’inscription qui n’était pas encore remplie et je coche la filière « mathématiques ».
C’est ainsi que je m’inscris en mathématiques. Trois années plus tard, en juillet 1991, je suis major de ma promotion en licence de mathématiques avec mention « Assez bien ». J’obtiens ensuite une inscription à l’école doctorale dans la même institution et une admission au second cycle de l’école normale supérieure (ENS) de Yaoundé. Deux années plus tard, je sors de l’ENS nanti du diplôme de professeur des lycées d’enseignement général, second grade, option mathématiques. Je pense que Monsieur Tankeu était pour moi, plus qu’un simple enseignant, un conseiller, un guide[44].
Cette histoire illustre à souhait l’évidence de l’effet de l’enseignant·e, c’est-à-dire l’influence de celui-ci ou de celle-ci sur le destin scolaire des apprenant·e·s en matière d’éducation et d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Dans ces deux domaines, cette aptitude à s’intéresser à la vie scolaire des enfants, à diagnostiquer leurs capacités et leur potentiel mathématique, est une « valeur ajoutée » qui, parmi d’autres, semble manquer le plus à nombre d’enseignant·e·s de mathématiques en Afrique. En l’absence d’un module d’éducation à la compréhension en formation initiale dans les écoles normales supérieures, les enseignant·e·s se retrouvent une fois de plus seul·e·s face à cet autre défi professionnel.
De même que la culture mathématique, il faut noter que la culture entrepreneuriale qui ambitionne autant le développement est, elle aussi, plus marquée dans d’autres régions du monde.
En 2009, une enquête Eurobaromètre de la Commission européenne a interrogé l’attitude des citoyens à l’égard du travail indépendant et de la création d’entreprise. Il en ressort, entre autres choses, que 28 % des citoyens interrogés affirment « très/plutôt faisable » de prendre le statut de travailleur indépendant dans les cinq années à venir, chiffre qui reste inférieur toutefois à celui des États-Unis (36 %) ou de la Chine (49 %).
C’est justement au sein des deux cohortes les plus jeunes (15-24 ans et 25-39 ans) que l’optimisme quant à la création d’une entreprise est le plus marquant. (Campy, 2014 : 26)
La différence de perception semble résider fondamentalement dans la mentalité collective, l’attitude acquise par les peuples à travers l’éducation et la culture au cours de l’histoire. Fanon (1961) avait déjà montré comment la colonisation a pu entraîner une forme de dépersonnalisation par l’infantilisation, l’oppression, la déshumanisation, l’acculturation et l’aliénation des peuples colonisés. Pour l’Afrique, la nécessité d’une nouvelle rationalité s’impose : « la nouvelle rationalité qui permettra d’avancer dans la connaissance du réel, il faudra la bâtir pas à pas, en ayant une conscience aigüe de la difficulté et de la singularité du problème posé. » (Anta Diop: 180). Selon lui, le développement du continent africain repose en grande partie sur cette condition qui voudrait qu’après avoir identifié ses problèmes et défini les priorités, l’Afrique s’efforce à faire la science autrement, à la bâtir selon ses visions, pour mieux réussir son processus d’émergence.
Quoi qu’il en soit, cette émergence souhaitée par l’Afrique ne deviendra réalité que si elle s’appuie sur le type de motivation et les adversités à l’entrepreneuriat multisectoriel chez les jeunes scolaris·e·és et non scolarisé·e·s. Selon les priorités, voici quelques facteurs qui peuvent pousser les jeunes à entreprendre : la recherche d’une autonomie financière et par conséquent matérielle, le besoin d’augmenter ses revenus, le besoin de réalisation de soi, et enfin, la découverte d’une solution à sa pauvreté. Les freins à l’entrepreneuriat chez cette catégorie de personnes sont en général liés non seulement à un cadre législatif légal trop contraignant, à un environnement et à un climat des affaires souvent peu favorables, mais aussi à une insuffisance de créativité; celle-ci étant héritée de la pédagogie de répétition/restitution – et non pas de la pédagogie de questionnement/stratégie – au travers de laquelle elles ont été formées. Or, que ce soient les motivations ou les freins, ces facteurs tirent tous leur origine de la maîtrise ou non des éléments (outils et concepts) du projet à mener et du modèle sociétal existant (le contexte). Les jeunes Africain·e·s font ainsi face à une double difficulté : une difficulté d’ordre intellectuel en rapport avec les capacités mathématiques (Soriano, 1998; OCDE, 2007) et une difficulté d’ordre conjoncturel. L’organisation du secteur entrepreneurial reste très débattue en Afrique.
Figure 1 : Nombre de procédures nécessaires à la création d’une entreprise.
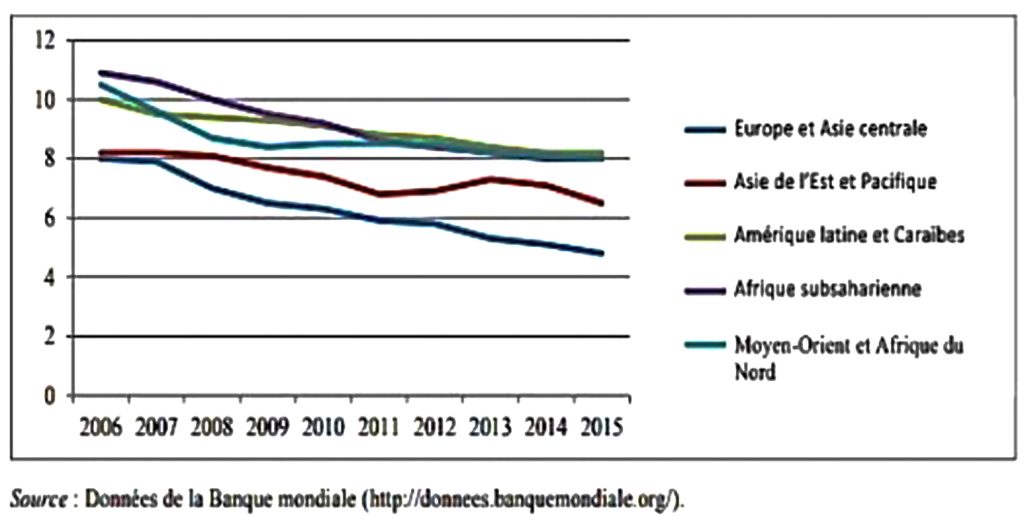
Le tableau ci-dessus montre qu’en Europe comme en Asie, les conditions de création d’une entreprise ont connu des allégements importants entre 2006 et 2015. Cependant, l’Afrique subsaharienne, malgré la grandeur de ses ambitions, reste un cadre peu propice en matière de création d’entreprise.
Aussi, la condition d’une émergence se trouve-t-elle dans un renversement de ces pesanteurs. Dans le cas spécifique des mathématiques, trop souvent, à la suite de quelques égoïsmes humains et des frustrations quant à leur bonne dévolution, elles engendrent des conflits de leadership (de nature non intellectuelle pour la plupart) et inspirent même parfois la méfiance dans les rangs des leaders et autres responsables de peu de foi. Ici, la contribution des responsables de l’éducation à cette transformation ne réside-t-elle pas dans un questionnement qui amènerait à s’interroger sur la nature, les principes et les motifs de l’enseignement des mathématiques?
- Selon l’UNESCO, ce ratio aura du mal à se réduire puisque le nombre d’enseignant·e·s formé·e·s n’arrive toujours pas à suivre le rythme d’accroissement démographique. ↵
- Un rapport de l’UNESCO (2006) sur les enseignant·e·s et la qualité de l’éducation en Afrique subsaharienne révèle qu’environ 50 % des enseignant·e·s du primaire sont des contractuel·le·s dont le salaire est de moitié moindre? ou inférieur? à celui des enseignant·e·s fonctionnaires. Ces contractuel·le·s sont bien souvent le recours à la pénurie d’enseignant·e·s. C’est le cas, par exemple, pour l’enseignement des mathématiques ou des langues vivantes. ↵
- "The 2009 Mathematics in Africa report describes low percentages of the population attending schools, high student-to-teacher ratios, heavy use of recycled European mathematics textbooks, and few prepared teachers in most of central Africa outside of Cameroon. All of these facts make it difficult to customize mathematics education for African students. Cameroon has a more developed education system, but at the college level it is struggling with filling the mathematics faculty positions that have been approved, and most mathematics teaching there is done in large classes by low-level staff." ↵
- Écriture phonétique du toponyme « Cameroun ». Dans cet ouvrage, j’adopte cette écriture pour faire l’unanimité dans la désignation linguistique de ce pays d’Afrique centrale, jadis protectorat allemand, puis placé en 1919 sous mandat de la Société des Nations qui à son tour conféra la tutelle de la partie orientale à la France, et la partie occidentale à la Grande-Bretagne. Depuis lors, il porte les noms de Cameroun (pour les francophones) et Cameroon (pour les anglophones). Cependant, j’emploierai les graphies françaises pour les adjectifs et les gentilés "Camerounais" et "Camerounaises" par respect des règles orthographiques du français. ↵
- C’est-à-dire dans les structures universitaires et grandes écoles africaines. ↵
- Sciences Mathématiques : il s’agit des séries « S », « SM » ou « C » dans lesquelles les sciences mathématiques et les sciences physiques sont des matières dites principales ou du 1er groupe. ↵
- Organisme chargée de la gestion de près de huit (8) examens et concours officiels au Ministère des enseignements secondaires, Yaoundé-Kamerun. ↵
- Structure camerounaise chargée de gérer 08 examens officiels du second cycle du sous-système anglophone. ↵
- Il s’agit d’un rapport bilan des résultats d’examens certificatifs produit par les inspecteurs de mathématiques aux niveaux régional et national à la fin d’une session. On y trouve une analyse critique et chiffrée des performances des candidat·e·s aux différents examens officiels camerounais. Les performances des apprenant·e·s y sont présentées par tranches de notes et un examen de la qualité des sujets (structure, taux de couverture des programmes, notions ayant posé le plus de problèmes aux candidats, etc.) est fait. Mais la production de ce document hautement important pour le suivi de l’enseignement sur le long et moyen terme, a été suspendue depuis 2018. ↵
- Il s’agit des sous-centres du Lycée Bilingue de Ngaoundéré (1 309 copies), celui du Lycée de Sabongari (1 382 copies) et celui du Lycée de Bamyanga (1 297 copies). ↵
- Pour répondre à cette question, il faudrait mener une étude de terrain plus détaillée. ↵
- Il s’agit généralement d’une épreuve en trois parties dont une partie algébrique, une partie géométrique et un problème. Les parties comprenant des exercices indépendants. L’exercice appelé « problème » contient parfois une suite de questions sur un sujet ou encore des parties relativement dépendantes. Le tout devant couvrir au moins 80 % du programme officiel de la classe de troisième. Et compte tenu de la densité de ce programme, l’épreuve remplit généralement les deux pages d’un papier de format A4. ↵
- Encore appelées filières STT. ↵
- Cela peut donner l’impression qu’il y a des gens qui en veulent aux mathématiques. Que non! Les mathématiques sont une science désincarnée. Ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent cette discipline qui font qu’elle existe. Les mathématiques comme toutes les activités scientifiques n’ont d’existence qu’à travers la pratique des hommes et des femmes. ↵
- Propos recueillis et condensés par l'auteur. ↵
- Dans l’enseignement secondaire comme au supérieur, le nombre de jeunes, qui redoutent les mathématiques en général et singulièrement sa branche fondamentale, reste important. Une infime partie d’entre eux et elles se lancent dans la filière des sciences appliquées. ↵
- Aussi faut-il épargner les enfants de seconde et première de ce type de pensées et les étudier uniquement à partir des classes de terminales. Nous y reviendrons plus loin. ↵
- "The Encyclopedia of Mathematics and Society is designed to provide students at the high school and undergraduate levels with a convenient source of information on the fundamental science and the mathematics behind our daily lives, explaining to students how and why mathematics works, and allowing readers to better understand how disciplines such as algebra, geometry, calculus, and others affect what we do every day. This academic, multiauthor reference work serves as a general and nontechnical resource for students and teachers to understand the importance of mathematics; to appreciate the influence of mathematics on societies around the world; to learn the history of applied mathematics; and to initiate educational discussion brought forth by the specific social and topical articles presented in the work." ↵
- Un atelier dénommé « MathComp4ALL » a été organisé le 18 mars 2015 sur le thème « Les interactions entre divers domaines de recherche avec les Mathématiques et l’Informatique », par le club des étudiant·e·s de Mathématiques et d’Informatique de la Faculté des Sciences à l’Université de Ngaoundéré en collaboration avec la Society for Industrial and Applied Mathematics - SIAM Student Chapter. Voir http://www.siam.org/students/chapters/current/UNIVNG.php. ↵
- Un état des ratios du nombre de docteurs Ph. D. par zone en Afrique pour l’année 2007 est présenté en annexe. ↵
- La connaissance des mathématiques permet d’établir une relation verticale dans la mesure où la connaissance d’une théorie mathématique donne accès à de nouvelles autres théories mathématiques. Par ailleurs, cette connaissance permet d’établir une relation transversale à partir du moment où elle s’ouvre à d’autres disciplines. ↵
- En attendant qu’une étude plus élaborée sur le sujet soit faite sur le terrain. ↵
- La corruption est un vice d’ordre moral avant d’être matériel. C’est simplement une conséquence de l’immoralité, de l’orgueil de transgresser la loi. Car comment expliquer que des individus nantis, socialement à l’abri du besoin matériel se retrouvent dans ce vice? ↵
- « Le terme d’anomie intervient chez Durkheim pour désigner l’absence ou la désintégration d’un système de normes. » (Poitou, 1981 : 114) ↵
- Dans un lycée de la place de Ngaoundéré en 2014, deux jeunes filles de classe de troisième ayant causé l’incendie d’un bâtiment scolaire ont été exclues définitivement par le conseil de discipline de l’établissement. Et leurs parents ont été sommés de faire toutes les réparations. ↵
- En 2016, des élèves d’un établissement secondaire public de la place ont été exclus avant la fin de l’année scolaire, pour avoir posté sur Facebook des images les montrant en tenue scolaire en train de danser dans un état d’ébriété et dans des conditions qui frisaient la pornographie. ↵
- Éducation pour tous. ↵
- Ceux et celles qui épousent le métier d’enseignant sans vocation ni conviction, mais simplement pour d’autres raisons qui leur sont propres. ↵
- Si chère au planétologue et philosophe camerounais Mbog Bassong (2012), auteur du livre La pensée africaine, Essai sur l’Universisme philosophique. ↵
- Selon l’ONU, le taux de croissance annuelle de l’Afrique subsaharienne est de 2,3 %. Voir population.un.org/wpp/DataQuery/. ↵
- Un exemple de confection et d’implémentation de l’enseignement des langues africaines s’appuyant sur les savoirs locaux nous est fourni dans Tourneux (2011). ↵
- Un ouvrage y relatif est en préparation. ↵
- Pour plus de détails sur cette question, on peut se rapporter à : http://afrique.le360.ma/autres-pays/culture/2018/11/13/23840-cameroun-polemique-un-manuel-de-5e-retire-de-la-vente-cause-de-passages-juges-deviants-23840. ↵
- Décret n° 2001/041 du 10 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration scolaire. ↵
- S’il est vrai qu’aucun texte de loi ne contraint les élèves au payement de cette contribution, on doit reconnaitre que dans les pratiques, ils y sont obligés sous peine de voir leur inscription dans l’établissement refusée. ↵
- Le Kamerun a fait un pas dans ce sens en 2010, voir MINEDUB (2010). ↵
- Cette question interpelle en priorité les praticien·ne·s des mathématiques en Afrique, leurs homologues de la diaspora, ainsi que les partenaires techniques et financiers intérieurs et extérieurs acquis à cette noble cause. ↵
- Concept inventé par l’anthropologue indien Shiv Visvanathan. Voir scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/chapter/en-quete-te-justice-cognitive/. Voir également Piron, Regulus, & Dibounje Madiba, 2016. ↵
- Il s’agit d’un ensemble de nouvelles disciplines scientifiques transdisciplinaires qui étudient la structuration et le fonctionnement du système nerveux (cerveau) humain et les processus mentaux. C’est ainsi qu’on parle de neuroscience de l’éducation, neuroscience cognitive, neuroscience sociale, neuroscience des mathématiques, neuroscience de l’apprentissage, etc. Pour d’amples informations, voir OCDE (2007). ↵
- Voir le site Cuk.Ch : http://www.cuk.ch/articles/1584/ ↵
- https://www.forbes.fr/classements/les-30-jeunes-entrepreneurs-africains-les-plus-prometteurs-en-2018/?amp. ↵
- Ce terme désigne le trouble de la capacité à lire, la difficulté à reconnaitre et à reproduire le langage écrit. ↵
- La malnutrition est une cause de l’échec scolaire. ↵
- Mon prochain ouvrage lui sera d’ailleurs dédié. ↵

